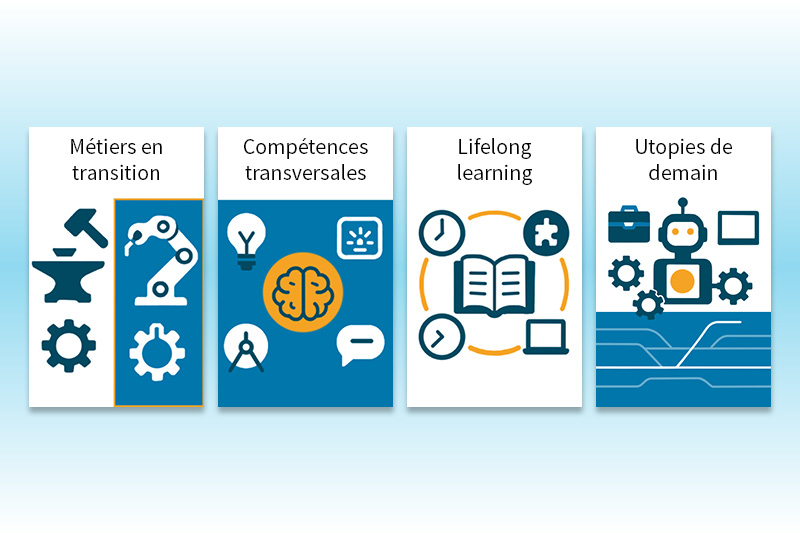Étude sur le choix professionnel
Exploration des métiers existants, multiplication des connaissances, gain d’assurance : les processus dynamiques à l’œuvre dans les décisions d’orientation des jeunes
Le choix de son futur métier s’inscrit dans un processus dynamique au sein duquel interagissent trois facteurs : le degré d’exploration de leur environnement par les jeunes, leur niveau de connaissance du marché des places d’apprentissage, et leur détermination dans leur choix professionnel. C’est ce que révèle une nouvelle étude qui montre que pousser les adolescents et adolescentes à se décider trop prématurément est contre-productif, et qu’il vaut mieux leur offrir un grand nombre d’opportunités d’exploration du monde professionnel. De fait, la meilleure manière pour les jeunes de réussir leur orientation est d’avoir une vague idée de ce qu’ils souhaitent faire plus tard et de procéder à une recherche ciblée d’informations sur le métier en question.
Si, au siècle dernier, la recherche avait encore tendance à décrire le choix de carrière comme un processus décisionnel statique, elle la définit à présent comme un processus non linéaire, de plus en plus dynamique et s’étalant tout au long de l’existence.
Nous prenons un très grand nombre de décisions dans notre vie (choix de la personne avec laquelle nous partagerons notre vie, lieu d’emménagement, par exemple). Cela étant dit, peu d’entre elles sont aussi complexes et ont d’aussi grandes répercussions que nos choix d’orientation professionnelle. Et les mêmes questions reviennent inlassablement au fil de notre existence : quel parcours professionnel souhaite-t-on poursuivre, quelle activité nous convient réellement et quelle formation doit-on suivre pour l’exercer ?
L’adolescence et le début de l’âge adulte constituent l’une des périodes les plus décisives pour les choix professionnels, puisque c’est généralement le moment où la première décision liée à l’orientation est prise, et où l’on franchit par conséquent une première étape décisive dans notre parcours professionnel qui durera toute notre carrière (Ashby et Schoon, 2010). Si, au siècle dernier, la recherche avait encore tendance à décrire le choix de carrière comme un processus décisionnel statique (voir, par exemple, Super, 1980), elle la définit à présent comme un processus non linéaire, de plus en plus dynamique et s’étalant tout au long de l’existence (voir, par exemple, Marciniak et al., 2022).
Les théories modernes observent que le comportement individuel (comme l’exploration active des métiers), les connaissances dont on dispose (sur le marché de l’emploi, par exemple) et l’attitude (ainsi la détermination par rapport à son choix) jouent un rôle déterminant dans le choix d’orientation professionnelle des jeunes (Marciniak et al., 2021), et que ces trois facteurs s’influencent les uns les autres (Gati et Asher, 2001 ; Peterson et al., 1996). Une recherche ciblée sur des métiers, par exemple, est susceptible d’élargir les connaissances de l’adolescent ou l’adolescente, lui apportant dès lors plus de clarté et d’assurance quant à son choix. Mais, à l’inverse, les nouvelles expériences (comme un stage) peuvent venir bousculer les objectifs du moment ou bien l’image que l’on a de soi, entraînant alors la nécessité de procéder à des réajustements.
Différents modèles tels que la Social Cognitive Career Theory (Lent et al., 1994) et la Happenstance Learning Theory (Krumboltz, 2009) mettent en évidence le fait que les décisions sont souvent soumises à des boucles de rétroaction dont les résultats peuvent déboucher sur de nouvelles connaissances, et où les hasards peuvent mener à de nouvelles opportunités. Les réflexions de nature rationnelle (par exemple quel est objectivement le meilleur poste à pourvoir ?) comme intuitive (par exemple qu’est-ce qui m’attire naturellement ?) peuvent jouer un rôle important dans ces effets de boucles de rétroaction (Xu et Flores, 2023). Les conseillers et conseillères d’orientation doivent ici veiller, en particulier, à ce que certains jeunes ne s’appuient pas trop sur leurs intuitions ou, au contraire, ne se retrouvent pas bloqués par leur désir de prendre une décision « optimale », désir qui les conduirait à collecter trop d’informations. Le modèle d’autorégulation du développement de carrière mis au point par Hirschi et Koen (2021), qui décrit l’interaction entre objectifs, connaissances et actions, offre des pistes intéressantes pour la pratique. Les auteurs y décrivent une circulation dynamique entre développement des objectifs, recherche d’informations, planification, mise en œuvre et feedback ; il s’agit d’un modèle particulièrement utile pour accompagner les processus de transition tels que le passage de l’école au monde professionnel (Akkermans et al., 2024).
Au-delà des modèles et théories, différents tours d’horizon de la littérature existante sur le sujet révèlent que le choix professionnel peut être favorisé, ou au contraire pénalisé, par divers traits de caractère (voir, par exemple, Blokker et al., 2023, Marciniak et al., 2022) : les jeunes consciencieux et proactifs rencontrent davantage de succès dans leur recherche professionnelle après l’école que les jeunes au locus de contrôle externe qui, à l’inverse, ont tendance à rencontrer des problèmes. Ces enseignements, certes importants, ne nous apprennent pas grand-chose toutefois sur les changements que produisent au fil du temps pour un individu les objectifs professionnels.
Nouvelle étude sur la dynamique à l’œuvre dans le processus du choix professionnel
Nous souhaitions comprendre ce qu’il se produit lorsqu’une personne s’écarte de son comportement habituel. Que se passe-t-il lorsque, tout à coup, quelqu’un se met à rechercher plus activement un métier que d’ordinaire ?
C’est précisément là qu’est intervenue notre recherche : nous souhaitions comprendre ce qu’il se produit lorsqu’une personne s’écarte de son comportement habituel. Que se passe-t-il lorsque, tout à coup, quelqu’un se met à rechercher plus activement un métier que d’ordinaire ? Ou lorsque quelqu’un d’autre se sent subitement plus assuré dans son choix professionnel qu’il y a de cela encore six mois ? Plutôt que de nous arrêter sur les différences entre les individus, nous avons ainsi examiné la façon dont le comportement exploratoire, les connaissances sur les métiers et la détermination professionnelle évoluaient au fil du temps pour une personne, ainsi que l’influence réciproque de ces trois aspects. Car, certes, un adolescent peut être globalement plus décidé que les autres jeunes de son âge (différences interpersonnelles), mais ses nouvelles expériences ou de nouvelles informations acquises peuvent dans le même temps aussi venir bousculer, au fil des mois ou des années, son choix professionnel ou l’évolution de son processus décisionnel.
Afin de mieux comprendre ces processus, nous avons accompagné, sur une période d’une durée totale de trente mois, 1132 jeunes sortant de l’école et s’apprêtant à entamer un apprentissage, ce qui nous a permis d’examiner dans le détail le développement dynamique naturel des processus de choix professionnel et de voir quels modèles se révélaient être particulièrement intéressants pour promouvoir de façon ciblée les métiers.
Nos interrogations
Nous tenions notamment à vérifier si le succès du processus de choix professionnel résidait avant tout dans le fait de récolter des informations sur les métiers avant de prendre sa décision, ou bien dans la présence d’un certain degré d’assurance en amont.
À en croire un grand nombre de guides et modèles dédiés à l’orientation professionnelle, récolter des informations sur les métiers avant de prendre sa décision porterait ses fruits, car les jeunes gagneraient ainsi en assurance par rapport à leur décision au fil du temps (voir, par exemple, Gati et Asher, 2001 ; Peterson et al., 1996). Nous soutenons toutefois, au contraire, que les jeunes doivent préalablement avoir une idée – quand bien même elle serait vague – de ce qu’ils souhaitent faire plus tard, ou bien prendre une décision a priori avant de se lancer dans une exploration plus ciblée des métiers. Nous tenions notamment à vérifier si le succès du processus de choix professionnel résidait avant tout dans le fait de récolter des informations sur les métiers avant de prendre sa décision, ou bien dans la présence d’un certain degré d’assurance en amont. Nous souhaitions par ailleurs examiner si ce processus décisionnel était tributaire de certaines interactions ou boucles de rétroaction. Pour cela, nous avons analysé trois aspects déterminants, à savoir :
- le degré d’exploration de leur environnement par les jeunes (par exemple les recherches effectuées sur les métiers, les stages d’observation, les discussions avec des professionnels) ;
- leur niveau de connaissance du marché des places d’apprentissage ;
- et leur détermination dans leur choix professionnel, c’est-à-dire le fait que les jeunes aient déjà ou non une idée claire de leur avenir professionnel.
Nos découvertes
Les données que nous avons collectées ont montré que le processus de choix professionnel était rarement linéaire. On observe plutôt une interaction, au fil du temps, entre les trois facteurs que sont l’exploration active des métiers, la connaissance du marché des places d’apprentissage et la détermination. Concrètement, cela signifie que les jeunes qui recueillent activement des informations gagnent ce faisant non seulement en connaissances sur les métiers, mais aussi souvent en assurance par rapport à leur choix. Inversement, on constate, dans le même temps, que les jeunes davantage informés sur les métiers se sentent plus sûrs dans leur décision et que leurs recherches d’informations sont par conséquent aussi plus ciblées. Ces observations nous ont permis de comprendre que le succès du choix professionnel des jeunes résidait dans le fait d’avoir déjà une vague idée de ce qu’ils souhaitent faire plus tard ainsi que dans la recherche ciblée d’informations sur les métiers concernés.
Exemples du quotidien
Imaginons donc Mia, une collégienne de quatorze ans. Au moment de réfléchir à son orientation, elle n’avait aucune idée de ce qu’elle souhaitait faire plus tard. Elle s’est donc rendue à une journée d’orientation où elle a eu l’occasion de discuter avec une infirmière. Elle a alors commencé à s’intéresser aux métiers des soins, ce qui l’a motivée à s’informer plus en détail sur la profession d’infirmière. Mia a également discuté avec des proches et décroché un stage d’orientation dans une maison de retraite. En multipliant ainsi ses connaissances sur le métier qui l’intéressait, elle s’est doucement mais sûrement sentie plus assurée dans son choix de métier.
Mais la situation inverse peut se produire également. Prenons Luca, quatorze ans, lui aussi collégien, convaincu de vouloir devenir informaticien. En recherchant plus d’informations sur cette profession, il réalise qu’en fait elle ne lui plaît pas. Moins assuré qu’auparavant, le jeune homme entame alors de nouvelles recherches, ce qui le conduira peut-être à découvrir une tout autre alternative.
Ces deux exemples montrent les effets de rétroaction qui peuvent se produire dans le choix de carrière : les informations obtenues peuvent apporter de la certitude comme elles peuvent semer le doute, et les décisions que l’on prend sont donc susceptibles de pousser à l’exploration comme elles peuvent remettre en question nos choix à cause de nouvelles informations obtenues (cf. Krumboltz, 2009).
Les enseignements pour la pratique
Les résultats que nous avons obtenus grâce à cette étude dégagent plusieurs pistes concrètes pour l’accompagnement des jeunes, tant au sein qu’en dehors de leurs établissements scolaires.
Les résultats que nous avons obtenus grâce à cette étude dégagent plusieurs pistes concrètes pour l’accompagnement des jeunes, tant au sein qu’en dehors de leurs établissements scolaires :
- Le choix de sa future profession est un processus, pas un événement unique dans sa biographie professionnelle. Les attentes des adolescents et adolescentes se développent progressivement au fil du temps et peuvent être soumises à un grand nombre de fluctuations, et une décision prise un jour n’est donc pas nécessairement une décision définitive (cf. Super, 1980).
- L’exploration porte ses fruits – et à plusieurs reprises. Les jeunes en recherche active d’informations sur les métiers, en quête de découvertes et de réponses à leurs questions gagnent non seulement en connaissances, mais y voient également plus clair sur leur projet professionnel. Ce qu’il faut comprendre, c’est que ces différentes actions exercent un effet avant la prise de décision, mais aussi après (cf. Kleine et al., 2021).
- Une décision n’est jamais définitive. Ce n’est pas parce que l’on a pris une décision que l’on cesse d’apprendre, bien au contraire : être au clair dans ses attentes peut motiver à se lancer dans une recherche d’informations plus ciblée pour être bien préparé aux prochaines étapes de son processus décisionnel lié à son choix de carrière (cf. Xu et Flores, 2023).
- Il faut laisser de la place aux changements de trajectoire. Prendre une décision ne conduit pas toujours au but que l’on s’est fixé, et c’est normal : les doutes, les changements de cap et l’élimination de certaines options font aussi partie du processus (cf. Gati et Kulcsár, 2021).
Conseils à destination des établissements scolaires, des parents et des conseillers et conseillères d’orientation
- Il ne faut pas forcer la main. Pousser les jeunes à prendre une décision prématurée peut se révéler contre-productif. Mieux vaut encourager l’exploration.
- Il faut mettre en place des opportunités d’exploration. Stages, salons des métiers, discussions avec des professionnels et visites d’entreprises sont autant de pistes d’exploration précieuses.
- Il faut renforcer la confiance. Il faut donner aux jeunes le sentiment et la conviction qu’il est tout à fait normal de ne pas encore être sûr de soi. Il faut également leur faire comprendre qu’ils auront besoin d’être épaulés au moment de leur orientation.
- Il faut rendre les informations tangibles. Les informations disponibles doivent être pertinentes et faciles à comprendre. Des techniques telles que des simulations de candidatures ou des discussions approfondies sur les conditions de travail des différents métiers peuvent faire des miracles.
Conclusion
Le choix professionnel des jeunes n’est pas un processus statique qui peut être planifié de façon optimale en amont. Au moment d’arrêter leur choix professionnel, les jeunes manquent souvent d’assurance, prennent parfois des décisions précipitées, et, surtout, ont une grande soif d’apprendre. Petit à petit, ils découvrent ce qui les intéresse, quelles sont leurs aptitudes et quelles voies s’offrent concrètement à eux. Notre recherche montre bien qu’en explorant activement le monde de l’emploi, les jeunes multiplient non seulement leurs connaissances sur les métiers, mais gagnent aussi en assurance dans leur parcours d’orientation et leurs choix. Dans le même temps, toutefois, il faut comprendre que le processus du choix professionnel se poursuit même après la décision prise, quand bien même on aurait l’impression que tout a déjà été décidé – on ajuste au cours de cette phase ultérieure sa décision, engage de nouvelles réflexions après avoir obtenu de nouvelles informations, adopte une nouvelle perspective en raison de nouvelles expériences vécues. Cette agilité est une force, et en aucun cas une faiblesse, car elle permet aux jeunes de façonner leur parcours professionnel non pas de manière figée, mais en réfléchissant et en faisant preuve d’auto-efficacité. Pour la pratique, cela signifie qu’un accompagnement de qualité saura identifier cette dynamique et l’exploiter. Un tel accompagnement passe par une incitation à l’exploration, une invitation à réfléchir et un soutien apporté aux jeunes pour qu’ils trouvent leur propre rythme, et ce en ayant conscience que le choix professionnel ne doit pas obligatoirement prendre la forme d’une ligne droite pour être une réussite (cf. Hirschi et Koen, 2021 ; Lent et Brown, 2013).
Haenggli, M., Hirschi, A., et Marciniak, J. (2025). Navigating transitions: A longitudinal exploration of career decision-making process dynamics in adolescents. Journal of Vocational Behavior, 159, 104125.
Bibliographie
- Akkermans, J., da Motta Veiga, S. P., Hirschi, A., & Marciniak, J. (2024). Career transitions across the lifespan: A review and research agenda. Journal of Vocational Behavior, 148, 103957.
- Ashby, J. S., & Schoon, I. (2010). Career success: The role of teenage career aspirations, ambition value and gender in predicting adult social status and earnings. Journal of Vocational Behavior, 77(3), 350-360.
- Gati, I., & Asher, I. (2001). Prescreening, in‐depth exploration, and choice: From decision theory to career counseling practice. The Career Development Quarterly, 50(2), 140-157.
- Gati, I., & Kulcsár, V. (2021). Making better career decisions: From challenges to opportunities. Journal of Vocational Behavior, 126, 103545.
- Hirschi, A., & Koen, J. (2021). Contemporary career orientations and career self-management: A review and integration. Journal of Vocational Behavior, 126, 103505.
- Kleine, A.-K., Schmitt, A., & Wisse, B. (2021). Students’ career exploration: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 131, 103645.
- Krumboltz, J. D. (2009). The happenstance learning theory. Journal of Career Assessment, 17(2), 135-154.
- Lent, R. W., & Brown, S. D. (2013). Social cognitive model of career self-management: toward a unifying view of adaptive career behavior across the life span. Journal of Counseling Psychology, 60(4), 557- 568.
- Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. Journal of Vocational Behavior, 45(1), 79-122.
- Marciniak, J., Hirschi, A., Johnston, C. S., & Haenggli, M. (2021). Measuring Career Preparedness Among Adolescents: Development and Validation of the Career Resources Questionnaire – Adolescent Version. Journal of Career Assessment, 29(1), 164-180.
- Peterson G. W., Sampson J. P. Jr, Reardon R. C., Lenz J. G. (1996). Becoming career problem solvers and decision makers: A cognitive information processing approach. Career Choice and Development, 3, 423–475.
- Super, D. E. (1980). A life-span, life-space approach to career development. Journal of Vocational Behavior, 16(3). 282-298.
- Xu, H., & Flores, L. Y. (2023). A Process Model of Career Decision-Making and Adaptation Under Uncertainty: Expanding the Dual-Process Theory of Career Decision-Making. Journal of Career Assessment, 31(4), 773-793.
Citation
Haenggli, M., Marciniak, J., & Hirschi, A. (2025). Exploration des métiers existants, multiplication des connaissances, gain d’assurance : les processus dynamiques à l’œuvre dans les décisions d’orientation des jeunes. Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique 10 (12).