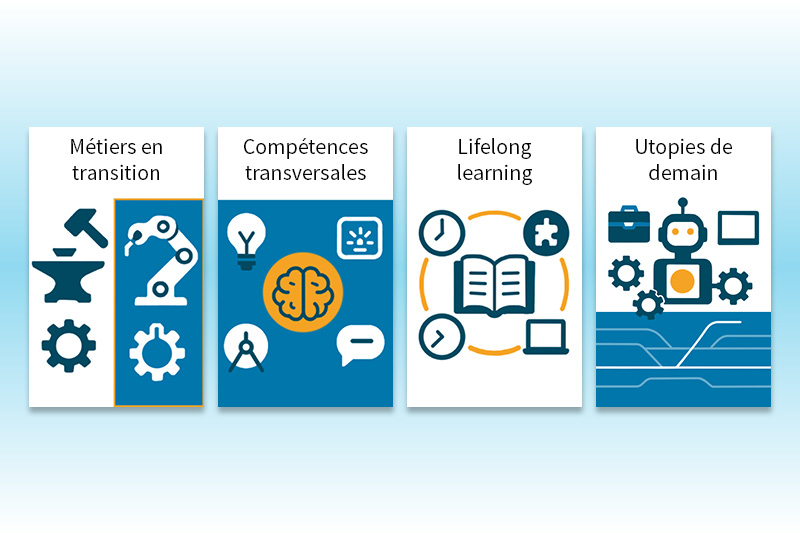Une étude de la HEFP décroche le prix de la formation professionnelle de la SRFP
Défis auxquels la formation continue de formateurs-trices fait face dans l’entreprise formatrice
Il est relativement habituel que les formateurs-trices (ci-après les FEE) dans l’entreprise formatrice suivent une formation continue professionnalisante ; en revanche, il est nettement plus rare de suivre des formations pédagogiques continues. Le présent article en examine les raisons. Il décrit les conditions relatives à l’activité des FEE et le défi de former des apprenti-e-s dans le contexte de la production. Les résultats confirment leurs besoins et attentes en termes de formation continue, révèlent les différents défis et laissent entrevoir divers profils de FEE. L’étude qui sous-tend la présente contribution a entre-temps abouti au développement de l’offre en formation continue « SwissEduPro ».
Dans la pratique, les conditions professionnelles ne prévoient que rarement (24 %) un allègement formel pour accompagner les apprenti-e-s.
En Suisse, l’apprentissage dual est la voie professionnelle la plus fréquemment empruntée à l’issue de l’école obligatoire (SEFRI, 2025). Pourtant, seules quelques rares études traitent du lieu d’apprentissage en entreprise et se concentrent sur les défis économiques (Schweri et al., 2021) ou didactiques (Filliettaz, 2011) de la formation initiale sur le lieu de travail. Les FEE dans l’entreprise formatrice sont la plupart du temps laissé-e-s pour compte, bien que leur rôle revête une signification clé lors de la transmission de connaissances et aptitudes professionnelles et lors de l’accompagnement des apprenti-e-s au cours de la transition de l’école vers la profession et vers l’âge adulte (Lamamra et al., 2019 ; Bahl, 2019 ; Besozzi, 2024).
Les FEE exercent une double fonction au sein de l’entreprise formatrice. Il s’agit-là d’un élément caractéristique : outre la profession principale dans laquelle elles et ils sont appelé-e-s à exercer, elles et ils ont par ailleurs une fonction de formation. Face à d’autres acteurs et actrices du système dual de formation professionnelle, les FEE sont davantage confronté-e-s à la problématique qui existe entre les pratiques de production et de formation (Moreau, 2003). À cet égard, la composante de formation passe souvent au second plan (Lamamra & Duc, 2021) ; dans la pratique, les conditions professionnelles ne prévoient que rarement (24 %) un allègement formel pour accompagner les apprenti-e-s (Wenger & Lamamra, 2023).
Prix de la formation professionnelle de la SRFP
Le présent texte se base sur un projet qui a remporté le prix 2025 de la formation professionnelle de la SRFP. L’étude en question comble une importante lacune de connaissances quant aux acteurs et actrices, souvent « invisibles », de la formation professionnelle duale, et contribue directement à améliorer la qualité, selon les autrices du document mentionné. Les résultats obtenus dans le cadre de ce projet servent de base au développement de dix cours spécifiques en formation continue, actuellement proposés sous le label SwissEduPro
Le second projet couronné porte le titre « Réalité virtuelle comme lieu d’apprentissage dans le cadre de la formation professionnelle initiale ». Le projet est salué pour avoir démontré avec brio le potentiel des technologies numériques dans la formation professionnelle. L’environnement d’apprentissage de réalité virtuelle « VOLT VR » permet aux futur-e-s électricien-ne-s qualifié-e-s de s’exercer de manière sécurisée et répétée au premier examen complexe ayant pour thème les installations électriques. Le projet a déjà été mis en œuvre par l’association professionnelle EIT.swiss. Il a par ailleurs obtenu la médaille d’argent du concours « AVRiL 2024 ». Le projet a déjà été décrit en détails dans Transfer.
Les besoins et les défis posés aux FEE
En raison de leur double fonction, les FEE ont également un besoin double en formation continue : l’un relatif à leur profession en soi et l’autre à une activité formatrice. La présente contribution apporte un éclairage sur ce besoin en formation continue. Le texte[1] se fonde sur un projet de la Fondation « Top-Entreprise formatrice », financé dans le cadre de la « Formation professionnelle 2030 ». Entre-temps, ce projet a débouché sur le développement de la filière professionnelle « SwissEduPro ». Des indications sur la méthode de sondage et des résultats approfondis figurent dans le rapport final relatif au projet (Wenger & Lamamra, 2024).
Quels souhaits les FEE ont-elles et ils en matière de formations pédagogiques continues ? Nous avons analysé cette question sous l’angle de ces dernières : durée annuelle souhaitée, plages temporelles considérées comme favorables (durant la journée, en soirée, pendant les week-ends), distance maximale de déplacement envisagée, ainsi que fenêtres temporelles appropriées durant l’année.
La durée souhaitée en matière de formations pédagogiques continues s’élève à 2,5 jours par an en moyenne, certain-e-s répondant-e-s (19,6 %) mentionnent jusqu’à trois jours par an, d’autres jusqu’à cinq jours durant l’année (9,7 %). Ces résultats indiquent la nécessité d’une reconnaissance de la fonction (Lamamra et al., 2019). Par ailleurs, elles et ils démontrent que la formation continue peut servir de tremplin menant à une activité davantage ciblée vers la formation et moins vers la production (responsable de formation ou enseignant-e-s en école professionnelle (Fassa et al., 2019).
En termes d’horaires et de moments propices à accomplir une formation continue, on observe une nette préférence pour les cours se déroulant sur des journées entières, même si plus de la moitié des personnes interrogées mentionnent également des formations réparties sur des demi-journées. Ce résultat pourrait être attribuable au fait qu’il est particulièrement difficile dans les PME de laisser de côté les exigences du quotidien professionnel. Des formats plus courts (par ex. d’une durée de deux heures), des formations effectuées en soirée ou encore durant les week-ends sont rarement considérés. Cette situation souligne l’intérêt marqué pour la formation continue. Les FEE souhaitent donc que celle-ci soit classée comme professionnelle et considérée comme faisant partie du temps de travail normal. Les personnes interrogées sont prêtes à assumer (en moyenne) 48 minutes de trajet au maximum entre le domicile et le lieu de la formation continue ; plus d’un tiers d’entre elles sont prêtes à effectuer un trajet d’une heure par jour.
Par ailleurs, cette préférence est l’expression d’un sentiment d’isolement que certain-e-s FEE ressentent à cet égard, la plupart d’entre eux ou d’entre elles n’ayant aucun-e collègue qui exerce la même fonction.
Le présent sondage soulevait également la question des formats et des modalités d’enseignement privilégiés. Plus de trois quarts des personnes interrogées privilégient les cours en présentiel, alors que les formes d’enseignement à distance et hybrides sont moins appréciées. Une formation continue est souvent considérée comme une activité chronophage. Préférer des cours en présentiel peut être synonyme d’effectuer des formations continues se déroulant durant les heures de travail ; cette condition n’est pas réellement valable dans le cas des formations à distance. Par ailleurs, cette préférence est l’expression d’un sentiment d’isolement que certain-e-s FEE ressentent à cet égard, la plupart d’entre eux ou d’entre elles n’ayant aucun-e collègue qui exerce la même fonction. L’enseignement en présentiel leur permet ainsi d’échanger avec d’autres personnes exerçant la même fonction.
En termes de modalités d’enseignement, le format de cours est le plus fréquemment sélectionné (trois quarts des personnes interrogées ont choisi cette option), suivi par l’échange d’expériences et par les workshops (48,7 % des personnes interrogées).
Différentes attentes entre FEE et employeur-euse-s
La formation continue représente un important objet de négociation vis-à-vis des employeur-euse-s : en effet, elle implique un congé de la part des FEE afin d’effectuer leur formation continue. L’occasion a été donnée d’analyser les différences entre les réponses des FEE et celles des employeur-euse-s. Cette comparaison montre que les offres de formation suscitent davantage d’intérêt de la part des FEE et que celles-ci et ceux-ci souhaitent plus de jours de formation continue par année que les employeur-euse-s peuvent en offrir. Il existe également des différences entre ces deux catégories en ce qui concerne le format des cours et les heures de réalisation.
Globalement, la comparaison révèle les différents défis des deux groupes considérés. Les FEE démontrent une volonté de suivre une formation continue, d’un besoin de reconnaissance et de professionnalisation, alors que pour les employeur-euse-s, ce sont les contraintes économiques qui figurent au premier plan. Les FEE semblent partir du principe que la formation pédagogique continue relève de la responsabilité de l’entreprise ; en revanche, les employeur-euse-s considèrent qu’elle devrait être prise en charge par les deux parties ou uniquement par les employé-e-s, et être souvent effectuée en dehors des heures de travail. Il en ressort également que le véritable défi réside en la reconnaissance du bénéfice à cet égard, en particulier de la formation pédagogique continue.
Thématiques les plus importantes abordées en formation continue
Nous avons également déterminé les besoins en formation continue des FEE et avons proposé sur cette base onze offres de cours sur une thématique spécifique (cf. illustration) et les avons présentées à choix.

Illustration : classement des offres de formation continue considérées comme étant les plus pertinentes. Graphique tiré de : Wenger & Lamamra (2024).
Il s’en détache trois thèmes, auxquels entre 50 % et près de 65 % des personnes interrogées s’intéressent. Ils soulignent les défis clés des FEE.
Il s’en détache trois thèmes, auxquels entre 50 % et près de 65 % des personnes interrogées s’intéressent. Ils soulignent les défis clés des FEE. En premier lieu figure la complexité en lien avec la diversité des rôles et des tâches, et la nécessité de délimiter les rôles individuels les uns des autres (Lamamra et al., 2019 ; Bahl, 2019). Le thème Connaissances du public adolescent relève que dans ce cas de figure, l’on va au-delà du travail de médiation et que l’on traite de l’accompagnement des jeunes personnes en prenant compte leurs particularités et leurs enjeux propres, que ce soit lors de la transition de l’école vers la profession ou du passage à l’âge adulte. L’accent mis sur les Compétences relationnelles et de communication indique que cette dimension revêt une signification clé pour la qualité de la formation et la question de savoir si l’on reste ou non dans une démarche de formation (Masdonati & Lamamra 2009 ; Berger et al., 2019).
Quatre profils de FEE
Nous avons réparti les personnes interrogées en quatre groupes en nous fondant sur leurs réponses.
- « les accompagnant-e-s »
- « les indifférent-e-s »
- « les assoiffé-e-s»
- « les investi-e-s »
Chaque groupe est constitué de personnes qui ont choisi des offres de cours similaires. Les accompagnant-e-s et les investi-e-s se distinguent entre eux/elles par leur rapport face à leur fonction, alors que les assoiffé-e-s et les indifférent-e-s présentent un rapport différent en termes de formation continue.
Les « accompagnant-e-s » se caractérisent par un intérêt accru pour les questions d’ordre social et familial ainsi qu’aux thèmes sociétaux (offres de transition et de soutien), et au soutien des jeunes. Ils/Elles estiment que leur tâche consiste non seulement à transmettre des connaissances et d’aptitudes professionnelles, mais aussi dans l’accompagnement des jeunes lors de leur entrée dans l’âge adulte et de la transition vers le monde du travail. Ce profil regroupe les personnes interrogées les plus jeunes, avec une forte prédominance de la tranche d’âge des 21 à 34 ans. Leur intérêt marqué à accompagner les jeunes pourrait s’expliquer par leur proximité d’âge.
Le groupe des « investi-e-s » se caractérise par une identité professionnelle marquée en tant que FEE. Les cours choisis par ces personnes impliquent avant tout leur rôle, leurs tâches et leurs défis, ainsi que la gestion de plusieurs rôles ou tâches de gestion, mais aussi la question de savoir comment l’on peut motiver les apprenti-e-s. Le défi consiste à assumer la fonction et, parallèlement, à savoir quelles sont les contraintes, les tensions et les difficultés qui découlent du fait que la personne de référence est simultanément l’instance pédagogique. La composition de ce groupe confirme ce défi : dans cette catégorie, les personnes âgées entre 45 et 65 ans, actives dans les petites entreprises, sont surreprésentées – il s’agit de FEE pour qui cette activité est rarement considérée comme principale –, elles sont soumises à une pression considérable et font face à des défis liés à leur fonction.
Le groupe des « assoiffé-e-s » se caractérise par un intérêt de portée quasiment générale ; nombre d’entre elles et eux ont choisi quasiment toutes les offres. Ces personnes pourraient être celles qui souhaitent se distancer de leur profession initiale et s’investir dans la formation continue. Toutefois, il s’agit-là peut-être aussi de FEE qui s’engagent pleinement dans leur fonction et qui souhaitent si possible continuer à se qualifier afin de pouvoir exercer un poste de formateur-trice à plein temps (centre de formation) ou d’enseigner sous une forme d’activité lucrative accessoire (école professionnelle). Il est également envisageable qu’il puisse s’agir-là de futur-e-s FEE qui souhaitent assumer cette fonction au moyen d’une formation continue à large échelle.
Les « indifférent-e-s » sont plutôt sceptiques en matière de formation continue, aucun thème n’éveillant particulièrement leur intérêt. Seuls 40 % citent des connaissances du public adolescent, 35 % des compétences relationnelles et de communication, et 31 % comprendre et soutenir les jeunes. Il pourrait s’agir de personnes qui se distancient aussi bien de la fonction que du travail et qui ne souhaitent pas s’investir dans la formation continue, peut-être aussi parce que les cours proposés n’ont pas correspondu à leurs attentes en une formation professionnelle continue. Ces personnes pourraient également avoir le travail comme centre d’intérêt ; elles sont convaincues qu’elles disposent de compétences requises pour favoriser le transfert de connaissances et d’aptitudes en raison de leur parcours professionnel actuel ou de leur poste (à responsabilité) ; elles partent donc du principe que la formation pédagogique continue est quelque chose d’extra-professionnel. Ce groupe rassemble principalement des hommes âgés entre 35 et 45 ans, et des responsables de micro-entreprises qui travaillent à plein temps.
Résumé
Les résultats suggèrent la mise à disposition de formations continues, comportant autant d’offres communes sur des thèmes majeurs, que des possibilités diversifiées selon le profil, le secteur, la fonction ou la taille de l’entreprise.[2] Le choix des cours devrait permettre une offre ciblée et adaptée aux besoins des FEE, sans prendre en compte des objectifs politiques ou économiques (par ex. la numérisation). La diversité des profils exige une adaptation des offres et des contenus de formation continue. Les réponses en termes de délai, de durée, de format et de modalité permettent d’adapter les offres de cours en ce qui concerne les exigences des FEE.
[1] Le présent texte est la version abrégée d’une contribution parue dans la revue « Education Permanente » (1/25). Le lien vers ce texte figure ici. [2] « SwissEduPro » propose entre-temps une filière correspondante.Bibliographie
- Bahl, A. (2019): Le/la formateur·rice: une position fragile. Étude de cas de grandes et moyennes entreprises, en Allemagne. In: Formation emploi, 146, 53-75.
- Berger, J.-L., Sauli, F., Wenger, M., & Gross, V. (2019): Evaluer la qualité d’une formation par les perceptions des participant·e·s: premiers résultats d’une recherche dans le contexte de la formation professionnelle initiale suisse. In: Gremion, C., Sylvestre, E. & Younes, N. (Hrsg.). Actes du 31ème Colloque scientifique international de l’ADMEE-Europe: Entre normalisation, contrôle et développement formatif. Évaluations sources de synergies? (S. 74–81). Lausanne, Suisse: IFFP et CSE de l’Université de Lausanne.
- Besozzi, R. (2024): Former des apprenti·e·s. A la rencontre des formateurs et formatrices en entreprise. Alphil.
- Fassa, F., Dubois, S., Wenger, M., & Ceppi, J. (2019): Les identités professionnelles des enseignant.e.s de la Formation Professionnelle Initiale vaudoise. Rapport de recherche. Lausanne: Université de Lausanne, Faculté des Sciences sociales et politiques, Observatoire de l’éducation et de la formation.
- Filliettaz, L. (2011): Collective guidance at work: A resource for apprentices? In: Journal of Vocational Education and Training, 63(3), 485-504.
- Lamamra, N., & Duc, B. (2021): Une perspective décentrée sur l’apprentissage en situation de travail: les conditions d’exercice des personnes formatrices en entreprise. In: Education & socialisation. 62
- Lamamra, N., Duc, B., & Besozzi, R. (2019): Au cœur du système dual: les formateurs et formatrices en entreprise. Résultats d’une recherche et pistes d’action pour les acteurs et actrices de la formation professionnelle. IFFP.
- Lamamra, N., Duc, B., & Besozzi, R. (2019): Im Herzen der dualen Berufsbildung: Berufsbildnerinnen und Berufsbildner. Forschungsergebnisse und Massnahmen für die Akteurinnen und Akteure der Berufsbildung. Lausanne: Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP.
- Lamamra, N., & Wenger, M. (2022): Quotidien et besoins des formateurs et formatrices en entreprise. Rapport d’analyse et propositions d’offres de formations continues. Renens: Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.
- Masdonati, J., & Lamamra, N. (2009): La relation entre apprenti·e et personne formatrice au cœur de la transmission des savoirs en formation professionnelle. Revue suisse des sciences de l’éducation. 31 (2), 335-353.
- Moreau, G. (2003): Le monde apprenti. La Dispute.
- SEFRI (2025) : La formation professionnelle en Suisse – explication succincte
- Schweri, J., Aepli, M., & Kuhn, A. (2021): The Costs of Standardized Apprenticeship Curricula for Training Firms. In: Empirical Research in Vocational Education and Training, 13(16).
- Wenger, M., & Lamamra, N. (2023): Les besoins et préférences en matière de formation continue des personnes formatrices d’apprenti·e·s. Analyses de l’enquête en ligne – Rapport final. Renens: Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.
- Wenger, M., & Lamamra, N. (2024): Weiterbildungsbedarf und Weiterbildungswünsche von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern. Analyse der Online-Befragung – Schlussbericht. Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB.
Citation
Lamamra, N., Wenger, M., & Fleischmann, D. (2025). Défis auxquels la formation continue de formateurs-trices fait face dans l’entreprise formatrice. Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique 10 (14).