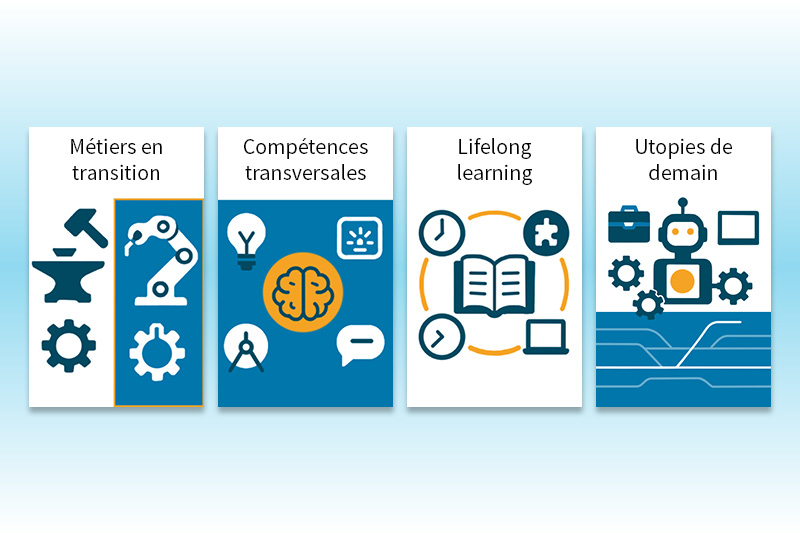Enquête auprès des personnes en formation en Suisse, partie 2 : comment les personnes formées vivent-elles leur formation ?
Beaucoup de jeunes se sentent mis au défi, mais peu se sentent surmenés
Élément central du système éducatif suisse, la formation professionnelle initiale constitue, pour la majeure partie des jeunes, le premier pas franchi dans le monde professionnel. Mais comment les personnes formées vivent-elles concrètement cette période déterminante de leur existence ? Telle est la question que s’est posée l’étude intitulée « La santé mentale des personnes en apprentissage ». Les quatre auteurs et autrices en ont résumé les principaux résultats dans quatre articles publiés dans le magazine Transfer. Le deuxième d’entre eux, ici présenté ici, s’interroge sur les défis rencontrés par les jeunes durant leur apprentissage, sur ce qui leur donne des forces et sur ce qui représente pour eux une charge.
Une proportion importante des personnes interrogées indique en outre trouver leur apprentissage passionnant la majeure partie du temps, être fières de travailler dans leurs entreprises formatrices et avoir le sentiment d’exercer un métier qui a du sens. Au total, près de 90 % des personnes formées se montrent satisfaites du métier qu’elles ont choisi d’apprendre. Il s’agit là de résultats très réjouissants.
Dans l’ensemble, la très grande majorité des jeunes vit positivement la période d’apprentissage : les trois quarts des personnes étudiées ont indiqué aller bien, voire très bien. 56 % d’entre elles recommanderaient du reste leur entreprise de formation sans réserve. Parmi les raisons les plus fréquemment citées pour cette recommandation se trouvent le soutien apporté par l’équipe de travail (48 %), le climat agréable (25 %) et la qualité du site de formation (17 %). 33 % des jeunes formés ne recommanderaient toutefois leur entreprise de formation que sous certaines conditions, quand 11 % d’entre eux ne la recommanderaient pas du tout (plus de détails sur les raisons de cette non-recommandation plus loin). Une proportion importante des personnes interrogées indique en outre trouver leur apprentissage passionnant la majeure partie du temps, être fières de travailler dans leurs entreprises formatrices et avoir le sentiment d’exercer un métier qui a du sens. Au total, près de 90 % des personnes formées se montrent satisfaites du métier qu’elles ont choisi d’apprendre. Il s’agit là de résultats très réjouissants.
Informations sur l’étude
Dans le cadre de l’étude « Santé mentale des apprentis. Biographie, stress, croissance et facteurs de réussite des apprentis dans la formation professionnelle duale en Suisse », des apprentis suisses ont été interrogés durant l’hiver 2024/25. Les réponses d’environ 45 000 jeunes de toutes les régions linguistiques ont pu être évaluées, ce qui constitue une base de données unique en termes de participation et d’approfondissement. L’étude a permis de recueillir des informations sur la manière dont les apprentis vivent leur formation, ce qui les motive et les renforce, mais aussi ce qui les stresse. Elle a également permis de déterminer comment ils évaluent leur santé mentale et quels sont les facteurs familiaux, sociaux ou scolaires qui y sont liés. L’étude a été réalisée par WorkMed AG, un centre pour le travail et la santé mentale qui s’occupe du travail et de la santé mentale dans la pratique et la recherche.
De plus amples informations méthodologiques sont disponibles dans le premier article publié dans Transfer.
Le début de l’apprentissage
La très grande majorité des personnes formées a choisi son métier de façon éclairée, s’est sentie prête à entamer son apprentissage et a eu hâte de commencer. Le lieu d’apprentissage effectif constituait une solution de dernier recours pour 18 % des personnes interrogées seulement. Les raisons fréquemment évoquées pour la joie ressentie à l’idée de commencer son apprentissage sont :
- l’envie de gagner de l’argent (88 %) ;
- l’occasion d’exercer une activité intéressante (83 %) ;
- l’autonomie et la prise de responsabilités (81 %) ;
- le fait de faire quelque chose qui a du sens (81 %).
Si de nombreuses personnes formées avaient hâte de commencer leur apprentissage, beaucoup s’inquiétaient également. Ont fréquemment été mentionnées les raisons d’inquiétudes suivantes :
- trop de devoirs à faire (63 %) ;
- heures de travail et congés (63 %) ;
- incompréhension face aux erreurs éventuellement commises / difficultés (60 %).
Sentiment d’efficacité personnelle
Compte tenu des changements importants qu’implique un apprentissage et de l’incertitude qui va de pair avec ces changements, les inquiétudes ressenties sont compréhensibles et « normales ». L’enquête révèle que, malgré leurs inquiétudes, les jeunes suivant un apprentissage s’en sortent très bien par rapport à leur nouvelle situation : la quasi-totalité des apprentis et apprenties (90 %) considère gérer plutôt bien, voire très bien les défis liés à l’apprentissage, c’est-à-dire qu’ils et elles éprouvent un sentiment d’efficacité personnelle. Le sentiment d’« efficacité professionnelle », également mesuré par l’étude, est lui aussi évalué positivement par les jeunes : plus de 80 % d’entre eux sont plutôt d’accord, d’accord, voire totalement d’accord avec le fait qu’ils se montrent à la hauteur des exigences de la formation et disposent des aptitudes requises. Des chiffres qui dénotent très nettement la présence d’une forte résilience chez la grande majorité des jeunes suivant un apprentissage. Il est par ailleurs à noter que le sentiment d’efficacité personnelle se renforce au cours de l’apprentissage.
Un groupe beaucoup plus restreint de jeunes, à ne pas négliger toutefois, explique en outre affronter avec moins de sérénité les difficultés rencontrées durant leur apprentissage ainsi qu’avoir moins confiance que les autres dans leur capacité à résoudre les problèmes.
Des différences apparaissent toutefois entre les deux sexes : les apprentis de sexe masculin enregistrent des valeurs plus élevées en matière d’efficacité personnelle et de sentiment de contrôle que les apprenties de sexe féminin. Un groupe beaucoup plus restreint de jeunes, à ne pas négliger toutefois, explique en outre affronter avec moins de sérénité les difficultés rencontrées durant leur apprentissage ainsi qu’avoir moins confiance que les autres dans leur capacité à résoudre les problèmes.
Les entreprises formatrices peuvent agir pour renforcer la confiance de leurs apprenants et apprenantes. Les accompagner de près pendant leur première journée, par exemple, facilite leur entrée dans cette nouvelle phase de leur existence. L’organisation d’une journée de bienvenue et la présence d’un programme d’initiation fixe sont aussi perçues comme utiles par les jeunes suivant un apprentissage. Un tiers d’entre eux environ ont participé à un événement en présence de leurs parents, sans toutefois que l’expérience soit toujours enthousiasmante : en comparaison avec le reste, les événements avec les parents sont considérés par les jeunes comme étant la mesure la moins utile. Un décalage apparaît ici entre le point de vue des personnes formées et celui de leurs formateurs et formatrices. Pour ces derniers et dernières, en effet, les parents ou les personnes référentes jouent un rôle tout particulièrement important, en particulier lorsque des difficultés surviennent en cours d’apprentissage : pouvoir compter sur une plus forte présence et un plus grand soutien parentaux est le besoin qu’ils et elles expriment le plus souvent (Schmocker et al., 2022).
Une très forte évolution personnelle par et grâce à l’apprentissage
L’un des principaux résultats de cette étude, auquel on ne s’attendait guère dans une telle proportion, est la très forte et large évolution positive personnelle des jeunes durant leur apprentissage. 80 à 90 % des personnes en formation environ se sentent plus responsables, plus travailleuses, plus ambitieuses, plus sociables et plus compétentes depuis qu’elles ont entamé leur apprentissage. Une large majorité indique en outre avoir gagné en persévérance. Autre résultat impressionnant : près de la moitié des jeunes en formation se dit plus motivée à se lever le matin qu’au temps des bancs scolaires, alors que, pour la majeure partie des jeunes suivant un apprentissage, le réveil sonne vraisemblablement plus tôt qu’autrefois. Si l’on tient compte du fait que l’horloge interne des jeunes connaît certaines transformations, les rendant fatigués plus tard le soir et leur donnant envie de dormir plus longuement le matin (Liamlahi, Hug et Benz, 2019), ce résultat exprime très nettement la motivation des jeunes en formation. Parmi les quinze progrès susceptibles de s’être produits depuis le début de l’apprentissage prédéterminés par l’enquête, les jeunes ont indiqué avoir fait des progrès (importants) dans douze d’entre eux en moyenne – des résultats qui soulignent le fait que l’apprentissage représente une très grande opportunité pour les jeunes et les fait progresser tant sur le plan professionnel que personnel. Les travaux de Basler et Kriesi (2022) indiquent eux aussi que l’apprentissage profite également à l’évolution personnelle des jeunes.
Les résultats montrent que 55 % des apprentis masculins et 72 % des apprenties féminines ont un locus de contrôle plus faible que la population suisse.
Le locus de contrôle des jeunes en apprentissage a également été examiné par l’étude. Cette notion désigne le niveau de croyance qu’a un individu dans le fait que ce qui se produit dans sa vie dépend de son comportement (Rotter, 1966). Si une personne a un locus de contrôle interne, elle aura confiance dans sa capacité à organiser sa vie selon ses envies, et témoignera moins souvent d’un état de stress. À l’inverse, si quelqu’un croit que, quoi qu’il fasse, cela ne changera strictement rien à sa vie, c’est-à-dire s’il a un locus de contrôle externe, alors il aura tendance à se sentir impuissant et dépendant des circonstances extérieures, ce qui peut l’affecter psychologiquement. Les résultats montrent que 55 % des apprentis masculins et 72 % des apprenties féminines ont un locus de contrôle plus faible que la population suisse (20 %, Schuler et al., 2016). Une différence qui ne surprend guère, dans la mesure où les jeunes suivant un apprentissage ont moins d’expérience que les adultes en matière d’autonomie décisionnelle et d’action – un grand nombre des décisions les concernant étant encore prises par leurs parents, leurs enseignants et enseignantes ou encore leurs formateurs et formatrices. Durant leur apprentissage, les jeunes évoluent du reste, selon le cas, dans un environnement plus ou moins hiérarchisé où leur marge de manœuvre est limitée. Cet état de dépendance et le fait que l’image qu’ils ont d’eux-mêmes est encore en cours de construction peuvent conduire les jeunes suivant un apprentissage à sous-estimer leur degré d’influence et à avoir un locus de contrôle davantage externalisé.
L’apprentissage peut être exigeant
D’un côté, les jeunes suivant un apprentissage rapportent donc très souvent vivre une expérience très positive. De l’autre, on observe pourtant également des inquiétudes, des craintes ou encore des troubles psychiques. À la question récapitulative portant sur l’effet général de l’apprentissage sur le bien-être, la moitié des jeunes a rapporté un impact positif, un tiers un impact négatif, et 15 % aucun impact. Ce qu’il faut comprendre derrière ces résultats ? Que les nouvelles exigences associées à l’apprentissage (nouveaux horaires à respecter, fait de devoir trouver sa place dans le « monde des adultes » ainsi que dans son nouveau rôle, nouvelles attentes en matière d’organisation personnelle, exigences ou attentes particulières des entreprises formatrices) et la réduction du temps de loisir créent un changement radical dans la vie des jeunes, ce qui explique sans doute pourquoi ces derniers perçoivent aussi un effet négatif de l’apprentissage sur leur bien-être. Plus de la moitié des jeunes suivant un apprentissage consacrent plusieurs moments de leur temps libre, chaque semaine, à faire leurs devoirs, qu’il s’agisse de travaux écrits ou de révisions. Par rapport à la période antérieure à leur apprentissage, 40 % des jeunes environ réduisent par ailleurs leurs activités de loisirs.
Près de la moitié des personnes interrogées a du reste songé au moins une fois à interrompre son apprentissage. Généralement, c’est le sentiment de surmenage ainsi que celui de n’être capable de rien (ou bien le sentiment qu’on leur donne de n’être capable de rien) qui poussent les jeunes à envisager cette interruption.
Près de la moitié des personnes interrogées a du reste songé au moins une fois à interrompre son apprentissage. Généralement, c’est le sentiment de surmenage ainsi que celui de n’être capable de rien (ou bien le sentiment qu’on leur donne de n’être capable de rien) qui poussent les jeunes à envisager cette interruption. Les difficultés relationnelles sont également citées comme autre motif important : certains jeunes rencontrent des problèmes avec les formateurs et formatrices, avec leurs professeurs, ou ne se sentent pas très bien dans leur équipe ou leur classe. Les jeunes qui se sentent soutenus par leurs formateurs et formatrices envisagent beaucoup plus rarement d’interrompre leur apprentissage. Cela vient souligner l’importance qu’il y a à assurer une bonne relation de travail entre le personnel de formation et les jeunes en apprentissage, et démontre que le climat de travail constitue globalement un facteur majeur.
Mais pourquoi alors les jeunes songeant à interrompre leur apprentissage ne le font-ils pas ? Pour une très grande majorité d’entre eux (81 %), c’est parce qu’ils ne veulent pas abandonner. Ne pas vouloir baisser les bras et décider de mener quelque chose jusqu’à son terme est une attitude fondamentalement positive et un facteur clé de la résilience. Outre la « volonté personnelle » des jeunes en formation, l’environnement social de ces derniers peut aussi jouer un rôle déterminant : le fait que leur entourage croit en eux, les encourage, ou que leurs parents s’attendent à ce qu’ils poursuivent leur apprentissage a en effet un impact positif pour beaucoup d’entre eux, et cela est d’autant plus vrai pour les jeunes qui ont une faible estime d’eux-mêmes, qui doutent d’eux et qui n’ont pas une grande confiance en eux.
Les relations et le climat de travail jouent un rôle majeur
L’étude a mis en lumière le fait que les relations humaines, environnement social inclus, jouaient un rôle particulièrement important dans le bien-être des jeunes en formation et dans la façon dont ces jeunes vivent leur apprentissage. Globalement, les résultats obtenus soulignent l’importance d’entretenir de bonnes relations au travail : la très grande majorité des personnes interrogées se dit satisfaite des formateurs et formatrices (81 %). Cette satisfaction se manifeste notamment dans le fait que les jeunes se sentent soutenus professionnellement et pris au sérieux par les personnes qui les forment. On observe un schéma sensiblement similaire à propos du personnel enseignant des écoles professionnelles. Concernant leurs entreprises de formation également, la grande majorité des jeunes (plus de 80 %) rapportent être traités de façon agréable et respectueuse, tout en se sentant encouragés et en percevant une bonne entente dans l’équipe. Le ressenti ainsi exprimé par les jeunes en apprentissage vient confirmer les estimations de diverses études attestant, le plus souvent, d’une grande motivation ainsi que de l’engagement des formateurs et formatrices dans l’accompagnement des jeunes formés (cf. Egger et al., 2024, Schmocker et al, 2022).
Les raisons de recommander les entreprises formatrices données par les jeunes le soulignent également : ce qui compte, surtout, c’est le fait de pouvoir bénéficier du soutien de son équipe ainsi que le climat de travail présent dans l’entreprise. Les témoignages suivants en constituent des exemples : « Excellent environnement de travail, tout le monde est très gentil, on peut toujours poser ses questions quand quelque chose n’est pas clair », « Le formateur est très gentil, il m’explique toujours tout dans le détail et n’hésite pas à m’expliquer les choses plusieurs fois si je ne comprends pas. » (témoignages d’origine inscrits dans le champ de texte libre).
Dans une très large mesure, le fait que les jeunes vivent positivement leur apprentissage est aussi déterminé, en plus des formateurs et formatrices, par les autres personnes constituant l’équipe. Quelles sont donc les interactions au sein de cette équipe ?
A contrario, quand ils trouvent leurs collègues antipathiques et agressifs, les jeunes indiquent qu’ils ne recommanderaient pas leurs entreprises formatrices ou qu’ils ne la recommanderaient que sous certaines conditions. Voici quelques exemples : « Mon chef a de grosses sautes d’humeur », « Beaucoup d’employés disent du mal de leurs collègues dans leur dos, impossible de faire confiance à qui que ce soit », « Environnement toxique (la cheffe me crie dessus, un employé boit de l’alcool pendant ses heures de travail, etc.), et beaucoup de responsabilités imposées rapidement (beaucoup trop pour un jeune en apprentissage). » (témoignages d’origine inscrits dans le champ de texte libre) Dans une très large mesure, le fait que les jeunes vivent positivement leur apprentissage est aussi déterminé, en plus des formateurs et formatrices, par les autres personnes constituant l’équipe. Quelles sont donc les interactions au sein de cette équipe ? Les relations interpersonnelles y sont-elles agréables et respectueuses ? À quoi ressemble le climat de travail dans l’entreprise ? Les jeunes en apprentissage sont-ils pris au sérieux ?
Si, dans l’ensemble, la perception de ces différents points est positive, un aspect de nature relationnelle noté bien plus négativement en comparaison se démarque : un quart des jeunes interrogés ont l’impression que leurs formateurs et formatrices ne s’intéressent pas à leur état (un résultat qui grimpe à 45 % avec le personnel enseignant des écoles professionnelles), et 23 % pensent que leurs formateurs et formatrices ne les soutiendraient pas s’ils allaient mal (un chiffre qui grimpe à 37 % avec le personnel enseignant des écoles professionnelles). Il apparaît donc que les responsables de l’apprentissage se font plus discrets quand il est question des sujets ou problèmes personnels des jeunes qu’ils et elles forment. Cela peut s’expliquer par les incertitudes des formateurs et formatrices en la matière : très souvent, ces dernières et derniers ne savent pas comment réagir aux problématiques « psychologiques », quand bien même ils et elles ont beaucoup d’expérience (Schmocker et al. 2022). Et, dans le même temps, les apprentis et apprenties s’adressent rarement (30 % des cas) à leurs responsables quand ils et elles vont mal ou envisagent d’interrompre leur formation. Il existe donc une certaine pudeur des deux côtés dès lors qu’il est question de sujets personnels ou d’ordre psychologique. On peut par conséquent se demander si l’idée, largement répandue, selon laquelle « les jeunes » aborderaient le sujet des troubles psychiques tout autrement que leurs aînés se vérifie réellement. Car, de fait, la difficulté à parler de ses problèmes psychologiques semble persister, à tout le moins dans le contexte de la formation et du travail.
Pistes pour la pratique
- En début d’apprentissage : accompagnement renforcé durant les premières semaines et intégration à l’équipe de travail.
- Manifester de l’intérêt : applicable par tout un chacun au quotidien, cette mesure de prévention peut se révéler très efficace.
- Demeurer respectueux : veiller à instaurer et maintenir un climat de travail agréable. Les cris sont proscrits.
- Renforcer l’efficacité personnelle : encourager les jeunes à faire preuve d’initiative, leur confier des missions, croire en eux, les inciter à persévérer même si ça n’est pas toujours simple, le tout en restant attentif aux signes de surmenage.
- Instaurer un climat d’apprentissage positif : montrer l’exemple en pratiquant une culture de l’erreur bienveillante, laisser la porte ouverte aux incertitudes, difficultés et questions éventuelles.
Sources
- Basler, A., & Kriesi, I. (2022). Die Veränderung informeller Kompetenzen zwischen dem Ende der obligatorischen Schulzeit und dem frühen Erwachsenenalter. Swiss Journal of Sociology, 48(2), 285-315.
- Egger, T., Lamamra, N., & Gonon, P. (2024). Weiterbildungsbedarf und Weiterbildungswünsche von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern. Zollikofen: Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB.
- Liamlahi, R., Hug, M., & Benz, C. (2019, 8. Mai). Schlafberatung bei Jugendlichen. pädiatrie schweiz. Abgerufen am [heutiges Datum], von
- Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1–28.
- Schmocker, B., Kuhn, T., Frick, U., Schweighauser, C., Baumgartner, R. Diesch, R., Ettlin, P., Frei, A., & Baer, N. (2022). Umgang mit psychisch belasteten Lernenden – Eine Befragung von Berufsbildner*innen in der Deutschschweiz. Binningen: WorkMed.
- Schuler, D., Tuch, A., Buscher, N., & Camenzind, P. (2016). Psychische Gesundheit in der Schweiz. Monitoring 2016 (Obsan Bericht 72). Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
Citation
Schmocker, B., Anastasiou, K., Heimgartner, D., & Baer, N. (2025). Beaucoup de jeunes se sentent mis au défi, mais peu se sentent surmenés. Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique 10 (12).