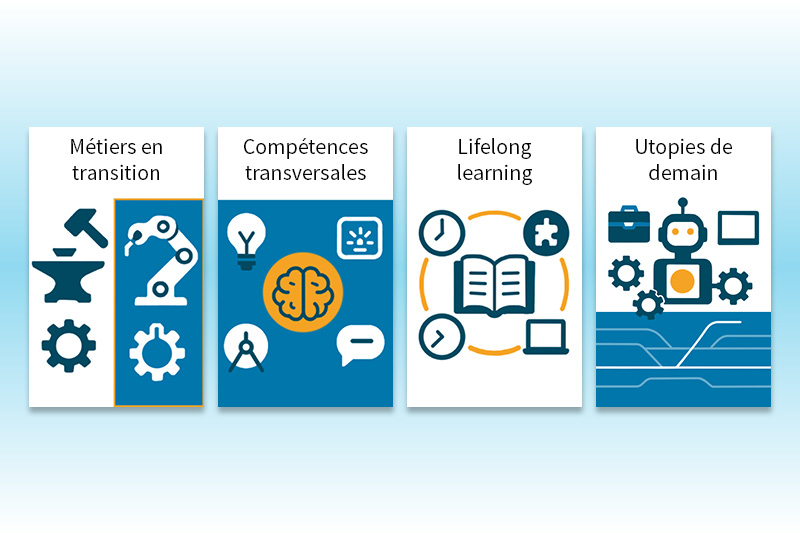Étude de la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest (HES-SO)
Employabilité et rôle des compétences acquises de manière non formelle et informelle
Comment maintenir son employabilité sur le marché de l’emploi quand on ne dispose d’aucun certificat fédéral de capacité ni d’aucun diplôme ? Une étude menée par la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest (HES-SO) révèle que les compétences acquises de manière non formelle et informelle constituent elles aussi des ressources-clés pour s’insérer sur le marché du travail. Trois entreprises sur quatre n’exigent en effet aucun diplôme formel pour pourvoir certains postes, tandis que l’expérience pratique et les aptitudes personnelles semblent être incontournables. Malgré cela, les compétences acquises de manière informelle sont souvent occultées. L’étude formule pour cette raison une série de propositions visant à aider les entreprises, le monde éducatif et les responsables politiques à mieux exploiter le potentiel des personnes ne disposant d’aucun diplôme formel.
Alors que nous vivons une transformation démographique et faisons face à une pénurie croissante de main-d’œuvre qualifiée, un groupe de personnes souvent marginalisé par la société gagne actuellement en visibilité dans les réflexions liées à la politique du marché de l’emploi et aux stratégies de formation : il s’agit des personnes ne disposant d’aucun diplôme formel. Bien que très expérimentés professionnellement dans certains cas et doués de compétences significatives, ces individus sont structurellement défavorisés sur le marché du travail en Suisse.
Au regard de ce contexte, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a chargé la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest (HES-SO) de mener une vaste étude visant à examiner les critères d’embauche utilisés par les entreprises pour les candidats et candidates ne disposant d’aucune qualification formelle, ainsi que l’insertion effective à long terme de ces personnes sur le marché de l’emploi. L’étude a notamment cherché à répertorier empiriquement le rôle joué par les compétences acquises de manière non formelle et informelle ainsi qu’à procéder à leur classement systématique.
Design de la recherche et objectifs poursuivis
L’enquête réalisée avait pour objectif d’apporter des réponses à deux questions fondamentales :
- Quels critères d’embauche sont appliqués aux personnes ne disposant d’aucune qualification formelle ?
- Comment ces personnes parviennent-elles à s’insérer efficacement et durablement sur le marché de l’emploi ?
L’enquête s’est également penchée sur la façon dont les entreprises évaluent et intègrent les candidatures des personnes ne remplissant pas les qualifications des profils de poste.
L’étude s’est appuyée sur des méthodes mixtes : elle a réalisé une enquête en ligne standardisée auprès de 726 entreprises suisses de différents secteurs et différentes tailles, ainsi qu’une série de 22 entretiens semi-directifs avec des expertes et experts, à savoir des responsables des ressources humaines, des formateurs et formatrices ainsi que des représentants et représentantes des mondes éducatif et politique.
Les données quantitatives recueillies ont fourni de solides estimations sur les stratégies de recrutement des entreprises ainsi que sur les critères d’évaluation qu’elles utilisent pour embaucher des personnes ne disposant d’aucun diplôme formel. Elles ont en outre permis d’analyser dans le détail les disparités apparaissant selon le secteur d’activité ainsi que les perspectives des acteurs de l’éducation et des décideurs politiques. Les données qualitatives ont quant à elles permis d’obtenir un aperçu des pratiques décisionnelles des entreprises, des expériences subjectives ainsi que des conditions institutionnelles en présence. Un modèle tridimensionnel d’employabilité intégrant les facteurs d’influence relevant de l’individu, de l’entreprise et des institutions a été utilisé pour l’analyse.
Pratiques de recrutement et évaluation des compétences informelles
Fait d’autant plus remarquable : 56 % des entreprises interrogées emploient actuellement au moins une personne ne disposant d’aucun diplôme formel, contre 39 % qui ne le font pas.
L’analyse a révélé que les compétences acquises de manière non formelle ou informelle représentaient un critère de recrutement important, mais dans le même temps aussi souvent peu visible. Fait d’autant plus remarquable : 56% des entreprises interrogées emploient actuellement au moins une personne ne disposant d’aucun diplôme formel, contre 39% qui ne le font pas. Deux tiers (67%) des entreprises interrogées considèrent les compétences de ces personnes comme importantes, voire très importantes. Les soft skills, en particulier, sont très demandées. Il s’agit par exemple de l’esprit d’équipe (77%), de la fiabilité (73%) et de la volonté d’apprendre (69%). Nombreuses sont les entreprises qui font passer les aspects pratiques au premier plan : l’expérience professionnelle (65%) et les recommandations (25%) sont ainsi plus importantes pour embaucher une personne que les notes obtenues à l’école (25% des réponses) ou les diplômes formels (42% des réponses). Il est à noter que 73% des entreprises interrogées indiquent qu’aucun diplôme formel n’est requis pour certains postes en particulier, tandis que l’expérience et les aptitudes personnelles demeurent primordiales.
L’image fournie par l’analyse est encore plus nette lorsque l’on observe la taille des entreprises et les secteurs d’activités concernés : là où les domaines techniques ou industriels et le bâtiment se comportent de façon majoritairement pragmatique dans leurs pratiques de recrutement, les services publics, le système de santé et la finance ont quant à eux souvent des attentes formelles minimales. Les petites entreprises, pour leur part, ont tendance à recourir à des processus de recrutement axés sur la pratique tels que les périodes d’essai, les recommandations ou encore les portfolios, tandis que les organisations de grande taille recourent plus fréquemment aux diplômes formels des candidates et candidats pour filtrer les candidatures quand celles-ci sont nombreuses.
Insertion dans l’entreprise : pratiques en place et défis rencontrés
87 % des personnes ne disposant d’aucun diplôme formel qui y sont employées sont placées à des fonctions clés et régulières – une réalité qui vient contredire l’hypothèse, pourtant courante, selon laquelle ces personnes occuperaient principalement une fonction auxiliaire.
Dans les entreprises choisissant délibérément d’employer des personnes ne disposant d’aucun diplôme formel, surtout, les stratégies d’insertion mises en place sont multiples. 87% des personnes ne disposant d’aucun diplôme formel qui y sont employées sont placées à des fonctions-clés et régulières – une réalité qui vient contredire l’hypothèse, pourtant courante, selon laquelle ces personnes occuperaient principalement une fonction auxiliaire. Les entreprises qui font ce choix d’embauche ajustent souvent leurs processus de recrutement : 58% d’entre elles indiquent procéder à un ajustement pour les candidats et candidates ne disposant d’aucun diplôme formel, par exemple en mettant ces derniers et dernières à l’essai, en modifiant la conduite de l’entretien d’embauche ou encore en demandant plus de références. Ces entreprises sont par ailleurs plus nombreuses en moyenne à recourir à des plans d’insertion structurés ou à des systèmes de qualification internes.
Des insuffisances sont toutefois rapportées dans le même temps, en particulier en ce qui concerne les compétences spécialisées et les méthodes de travail. Cela apparaît nettement avec les entreprises ayant délibérément choisi d’employer des personnes ne disposant d’aucun diplôme formel : 85% d’entre elles voient un retard à rattraper à ce niveau et évaluent nettement mieux les compétences sociales et personnelles des personnes concernées. Cette répartition des compétences souligne à quel point les compétences informelles se situent essentiellement dans le domaine des soft skills, tandis que les diplômes formels sont souvent associés au socle de compétences pratiques.
Les personnes provenant d’horizons différents, c’est-à-dire les personnes exerçant un autre métier que celui qu’elles ont appris – un profil que l’on retrouve dans 76% des entreprises interrogées –, forment un groupe particulier en matière de compétences informelles. Comme pour les personnes disposant de faibles qualifications formelles, les opportunités professionnelles de ce groupe de travailleurs et travailleuses reposent dans une large mesure sur des compétences acquises de manière non formelle ou informelle. Près de 59% des entreprises interrogées soulignent le fait que les personnes provenant d’horizons différents disposent de compétences acquises dans leurs anciens métiers qui peuvent être mobilisées dans l’entreprise. C’est le cas, par exemple, de la gestion de projet, de la capacité à résoudre des problèmes ainsi que de l’esprit d’équipe. Ces compétences acquises antérieurement comptent d’ailleurs parmi les principaux motifs de recrutement pour un tiers des entreprises (34%), qui font ainsi passer le potentiel de développement de leur personnel avant son adaptation formelle.
Invisibilité des compétences informelles et impact symbolique des diplômes
Nombreux sont en effet les responsables des ressources humaines interrogés qui ont rapporté considérer les diplômes formels comme une preuve de la capacité d’apprendre, de la fiabilité et des capacités sociales des candidats et candidates. Or, cela débouche de fait sur une discrimination systématique des personnes dont les compétences ont été acquises en dehors des parcours de formation formels.
L’analyse qualitative a mis en lumière un point de tension fondamental, à savoir le fait que les compétences informelles ne sont généralement reconnues qu’une fois la preuve de la qualification formelle apportée. Nombreux sont en effet les responsables des ressources humaines interrogés qui ont rapporté considérer les diplômes formels comme une preuve de la capacité d’apprendre, de la fiabilité et des capacités sociales des candidats et candidates. Or, cela débouche de fait sur une discrimination systématique des personnes dont les compétences ont été acquises en dehors des parcours de formation formels, car le fait que les atouts individuels acquis de manière informelle soient invisibles agit comme une barrière structurelle, même dans les entreprises pourtant ouvertes aux personnes provenant d’autres horizons.
Il apparaît du reste nettement de l’étude que la reconnaissance des compétences informelles par les employeurs dépend souvent de la conjoncture : quand la main-d’œuvre qualifiée vient à manquer, ou quand des profils spécifiques sont recherchés, les entreprises sont en effet plus enclines à renoncer aux diplômes formels. À l’inverse, quand les candidatures sont nombreuses ou bien dans les professions soumises à une certaine réglementation, les exigences formelles tendent à dominer, et cette sélectivité rend plus difficile la prise en compte systématique des compétences informelles.
La perspective côté employeurs
Nombreuses sont les personnes sans aucune qualification formelle qui ont des compétences professionnelles solides acquises par leur histoire migratoire, leur travail de soins, leur expérience de bénévolat ou leur expérience pratique. Pour autant, pourtant, ces personnes n’arrivent généralement pas à mobiliser leurs compétences dans le cadre d’un processus de qualification formel. Les experts et expertes interrogés ont mentionné plusieurs barrières expliquant cela : manque d’informations, manque d’assistance, barrière de la langue et problème de la très grande complexité institutionnelle. En maints endroits, la confiance des gens dans les procédures de reconnaissance des acquis est par ailleurs faible, ce qui crée un cercle vicieux : les acquis de l’expérience ne sont pas reconnus, puisque les compétences informelles de la personne ne sont ni prouvées ni visibilisées, et les compétences ne peuvent pas être développées par la suite faute de cette reconnaissance des acquis.
Recommandations d’action pour la pratique, le monde éducatif et les décideurs politiques
En se basant sur les résultats obtenus, l’étude a formulé une série de recommandations spécifiques destinées à quatre groupes cibles. Il est à noter toutefois que des mesures doivent impérativement être prises à tous les niveaux si l’on souhaite rendre visibles, reconnaître et développer les compétences informelles.
Les quatre groupes cibles sont :
- les personnes employées ;
- les entreprises ;
- les établissements de formation professionnelle et
- les décideurs politiques.
Les personnes employées doivent se voir offrir de meilleures opportunités de réfléchir à leurs compétences et de les documenter. Les formats faciles d’accès tels que l’aide à la création d’un portfolio, les bilans de compétences ou encore les services d’assistance pour faire valider ses acquis peuvent donner une orientation tout en étant source de motivation. L’attitude du monde éducatif doit pour cela cependant être positive, nombreuses étant les personnes interrogées disant ressentir les formations formelles comme une expérience étrangère, pesante ou stigmatisante. L’efficacité personnelle et la motivation des apprenants et apprenantes peuvent être encouragées en déployant des stratégies visant à leur redonner du pouvoir d’agir ainsi qu’en mettant en place des environnements d’apprentissage tournés vers leurs communautés (p. ex. en partant directement de la situation vécue par la personne ou en encourageant le soutien entre pairs). La flexibilité temporelle, la sensibilité interculturelle, la proximité des contenus d’apprentissage avec la réalité vécue par les apprenants et apprenantes et le fait de pouvoir s’adresser directement aux personnes responsables sont des points essentiels également.
Les entreprises sont appelées à lever les yeux de la pure certification formelle pour voir plus loin. La mise en place d’un recrutement s’intéressant de manière ciblée au potentiel niché dans les compétences informelles requiert des processus de sélection transparents et pluridimensionnels, lesquels peuvent s’appuyer sur des portfolios, des entretiens menés à plusieurs niveaux, des procédures d’intégration structurées ou encore des évaluations des acquis réalisées en interne. Les formats nécessitant une participation active des personnes employées dans le développement de leurs compétences (p. ex. les objectifs de formation participatifs, l’apprentissage entre pairs ou les outils de feedback) fonctionnent particulièrement bien. Une meilleure coordination des processus RH est du reste requise, et ce depuis le recrutement jusqu’au développement du personnel en passant par l’intégration des nouvelles personnes employées. Des outils tels que les grilles de compétences ou les catalogues d’objectifs de formation notamment peuvent aider à documenter systématiquement les performances d’apprentissage informelles des apprenants et apprenantes.
Du côté des établissements de formation professionnelle, un défi majeur est d’améliorer la perméabilité entre les compétences acquises de manière informelle et les qualifications formelles. Un accès individualisé à l’embauche peut être assuré en instaurant des qualifications complémentaires modulaires, des formats hybrides et des systèmes de reconnaissance partielle. Adapter la communication et la stratégie didactique aux groupes de personnes éloignés du monde de la formation est particulièrement important. On peut pour cela s’appuyer sur des grilles de compétences simplifiées, des processus de validation des acquis axés sur l’agir des apprenants et apprenantes, des certificats de branche ou des outils au format numérique tels que les autotests, les journaux de bord d’apprentissage ou encore les plateformes d’apprentissage entre pairs. Les projets pilotes menés montrent que ces approches fonctionnent bien lorsqu’elles sont menées localement, en restant proche de la pratique et en proposant un accompagnement tenant compte des ressources disponibles.
Une meilleure gouvernance des processus de validation des acquis de l’expérience est requise, de même qu’une coordination à l’échelon national pour faire converger les processus existants qui peuvent être fragmentés, difficiles d’accès et gourmands en ressources, ainsi que pour garantir la qualité tout en améliorant la visibilité des compétences informelles.
Les décideurs politiques fédéraux et cantonaux, pour finir, sont eux aussi tenus d’améliorer les conditions de reconnaissance des compétences acquises de manière informelle. Une meilleure gouvernance des processus de validation des acquis de l’expérience est requise, de même qu’une coordination à l’échelle nationale pour faire converger les processus existants qui peuvent être fragmentés, difficiles d’accès et gourmands en ressources, ainsi que pour garantir la qualité tout en améliorant la visibilité des compétences informelles. Cela peut par exemple prendre la forme de pôles de reconnaissance des acquis centralisés ou bien de plateformes numériques. Des instruments incitatifs mis en place par les décideurs politiques pourraient du reste encourager l’insertion des personnes peu qualifiées par les entreprises. Il peut par exemple s’agir de subventions salariales, de systèmes de mentorat ou de fonds de qualification régionaux. Des espaces propices à l’innovation doivent enfin être mis à profit pour tester les nouveaux formats de validation des acquis.
Il convient ce faisant de tenir compte des disparités propres à chaque secteur : des parcours de qualification et d’attestation des compétences accompagnés doivent être développés pour les domaines soumis à une réglementation exigeant l’existence de certains diplômes formels, tandis que les domaines moins soumis à la régulation peuvent s’appuyer davantage sur la validation directe des compétences. Des formats d’assistance sur mesure tenant compte des particularités linguistiques, culturelles et biographiques doivent par ailleurs être proposés aux groupes spécifiques tels que les personnes issues de la migration, les travailleurs et travailleuses âgés ou les chômeurs et chômeuses de longue durée. Le développement de projets pilotes menés au plus près du marché de l’emploi, comme les pôles de compétences régionaux, est en outre recommandé, de même que leur graduation ciblée. Mesurer systématiquement l’efficacité des processus en recourant à des indicateurs clairement définis est par ailleurs essentiel pour assurer en continu la qualité et l’utilité concrète des processus de validation des acquis. En complément de ces différentes mesures, des campagnes d’information et de sensibilisation de grande ampleur doivent être proposées au grand public pour l’aider à mieux comprendre l’importance des compétences informelles et déconstruire les stéréotypes. Ces campagnes doivent mettre l’accent sur les exemples de bonnes pratiques, les réseaux intersectoriels, les plateformes numériques et les instruments de reconnaissance des acquis dans le but de mettre en lumière l’importance que revêtent, pour le marché de l’emploi, les compétences acquises de manière informelle.
Résumé : la visibilité crée de l’employabilité
L’étude menée a révélé que les compétences acquises de manière non formelle et informelle formaient, dans le marché du travail en pleine mutation, un potentiel déterminant et jusqu’à présent sous-exploité pour le recrutement. La reconnaissance systématique de ces acquis requiert toutefois non seulement des solutions techniques, mais aussi des transformations culturelles : employeurs, instituts de formation et responsables politiques doivent en effet créer de nouveaux ponts entre les acquis de l’expérience personnelle et la qualification formelle, entre la pratique et les diplômes ainsi qu’entre le potentiel individuel et sa reconnaissance, car l’employabilité d’une personne ne passe pas uniquement par sa qualification formelle – elle naît aussi de son expérience quotidienne, de son travail au sein de l’entreprise et plus largement de la diversité des parcours de vie individuels. Or, en rendant cette diversité visible, on augmente non seulement les chances des personnes concernées de participer à la vie active, mais on améliore aussi la pérennité d’un marché de l’emploi tourné vers l’inclusivité.
Quatre grands principes doivent être pris en compte pour assurer le succès de ce processus. Premièrement, il convient d’intégrer l’ensemble des mesures prises dans le système dans son ensemble afin que la formation duale tant éprouvée n’en ressorte pas affaiblie, mais au contraire enrichie de manière ciblée. Deuxièmement, la maîtrise de la langue doit être encouragée dans toutes les mesures prises, car elle représente un facteur d’insertion fondamental sur le marché de l’emploi ainsi que dans les formations continues. Troisièmement, le principe « pas de diplôme sans passerelle vers d’autres formations » doit prévaloir, c’est-à-dire que toute étape intermédiaire atteinte par une personne doit ouvrir des passerelles et ainsi créer des perspectives d’insertion durables sur le marché de l’emploi. Quatrièmement, enfin, la formation professionnelle formelle avec octroi d’un diplôme reconnu au niveau fédéral demeure le pilier fondamental du système auquel peuvent venir s’ajouter judicieusement des qualifications supplémentaires non formelles.
Le rapport de l’étude peut être téléchargé à cette adresse.
Citation
Imboden, S. & Glatzl, E. (2025). Employabilité et rôle des compétences acquises de manière non formelle et informelle. Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique 10 (14).