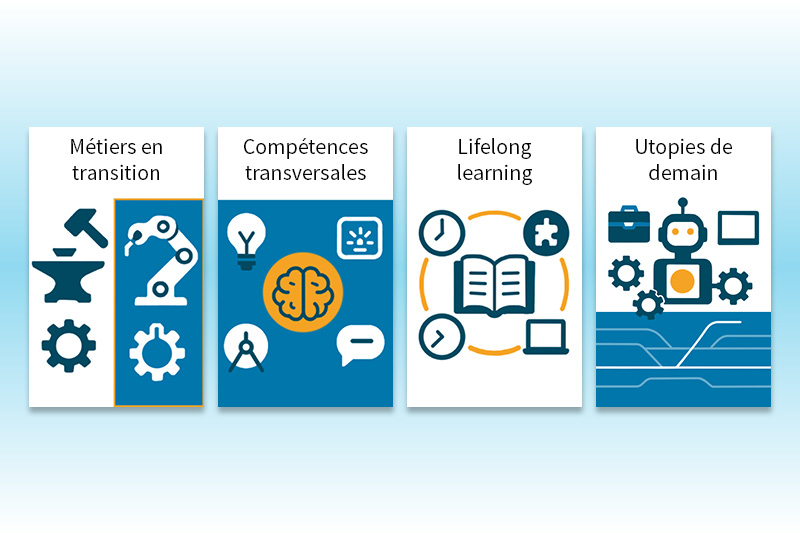Nouveau livre paru aux éditions hep
Les réseaux d’entreprises formatrices comme prestataires de services
Les réseaux de formation permettent aux entreprises formatrices de coopérer tout en proposant des services tels que le recrutement ou des formations pratiques de base structurées. L’article ici présent revient sur la naissance de ces réseaux spécialisés en Suisse, sur les différentes formes qu’ils prennent ainsi que sur les défis qu’ils rencontrent. Si les espoirs placés à l’origine dans la création de ces réseaux n’ont pas été comblés, les services qu’ils proposent peuvent jouer un rôle déterminant dans certaines niches. Le présent article s’appuie sur une série d’études de cas qualitatives ainsi que sur un livre paru en 2024 aux éditions hep, Ausbildungsverbünde (« Les réseaux d’entreprises formatrices », ouvrage paru en allemand uniquement).
1 Situation de départ et état de la recherche
La notion de « réseaux d’entreprises formatrices » recouvre une large palette d’arrangements entre entreprises formatrices allant de la mise en commun des apprentissages dispensés à l’externalisation de certains éléments des formations.
Les formations professionnelles dispensées dans le cadre du système dual reposent sur la prise en charge de la formation par les entreprises, et nombreuses sont ces dernières qui participent à ce système parce qu’il leur profite directement économiquement : les personnes formées participent activement à la production de l’entreprise durant leur apprentissage, et les coûts liés au recrutement et à la formation des nouvelles personnes sont moindres. Malgré tout, toutes les entreprises ne participent pas au système de formation professionnelle : certaines y renoncent faute de capacités internes, faute de spécialisation ou en raison de la surcharge de travail qu’implique la formation (BMBF, 2024 ; Dornmayr, 2023 ; CSRE, 2023).
Pour pallier ces difficultés, des coopérations entre entreprises formatrices sont apparues en Suisse, en Allemagne et en Autriche. La notion de « réseaux d’entreprises formatrices » recouvre une large palette d’arrangements entre entreprises formatrices allant de la mise en commun des apprentissages dispensés à l’externalisation de certains éléments des formations. Les études réalisées sur ce système de réseaux laissent apparaître un schéma récurrent : des pics de nouvelles coopérations surviennent en temps de crise, les coopérations prennent des formes très variées, leur diffusion est globalement limitée, et les facteurs de nature économique jouent un rôle majeur côté entreprises (Ebbinghaus/Dionisius, 2020 ; Lachmayr, 2009 ; Leemann, 2019).
2 Développement des réseaux en Suisse
2.1 Années nonante : impulsion donnée par les arrêtés sur les places d’apprentissage
La crise conjoncturelle survenue dans les années nonante a débouché sur le versement de subventions exceptionnelles (« arrêtés sur les places d’apprentissage »), lesquelles ont permis de financer de nouveaux concepts, des guides ainsi que les premiers réseaux d’entreprises formatrices (Gertsch, 1999). Quantité d’acteurs et de modèles de renom sont apparus au cours de cette phase, qui a débouché notamment sur l’ouverture des ateliers de formation des grandes sociétés aux entreprises externes (comme les centres de formation de Winterthour ou libs), ou encore la constitution de réseaux agissant au niveau sectoriel ou national (comme login). L’idée était alors de créer de nouvelles places en apprentissage grâce aux coopérations tout en assurant la qualité de la formation initiale.
2.2 Cadre juridique en vigueur depuis 2022 et faible diffusion des réseaux
Les réseaux d’entreprises formatrices se sont moins solidement établis dans le paysage de la formation initiale que ne l’escomptaient à l’origine les responsables politiques en charge de la formation professionnelle : en 2024, seuls 2,3 % des diplômes de la formation professionnelle initiale ont été obtenus à l’issue d’une formation suivie dans un réseau d’entreprises formatrices.
La révision de la Loi sur la formation professionnelle (LFPr) et l’Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) ont explicitement implanté les réseaux d’entreprises formatrices au sein du système de formation professionnelle (Conseil fédéral, 2003, article 6, aliéna c ; Assemblée fédérale, 2002, article 16, alinéa 2a). Outre les réseaux de formation, les dispositions alors conclues autorisent à enchaîner les contrats d’apprentissage au sein de plusieurs entreprises ainsi qu’à organiser des formations complémentaires entre entreprises, une pratique très courante bien que non standardisée explicitement. Plusieurs cantons ont mis sur pied des outils de promotion, mais d’autres y ont renoncé. Résultat : la latitude dont disposent les cantons pour créer, faire fonctionner et financer les réseaux diffère d’un canton à l’autre.
Dans tous les cas, les réseaux d’entreprises formatrices se sont moins solidement établis dans le paysage de la formation initiale que ne l’escomptaient à l’origine les responsables politiques en charge de la formation professionnelle : en 2024, seuls 2.3% des diplômes de la formation professionnelle initiale ont été obtenus à l’issue d’une formation suivie dans un réseau d’entreprises formatrices (OFS, 2025).
3 Différents formats et services
Dans la pratique, ce sont surtout les services proposés par chacun des réseaux qui les distinguent les uns des autres (Maurer et al., 2024) :
- Services dédiés à la mise en œuvre pratique de l’apprentissage
Demandes d’autorisations de former des apprenti·es, promotion des places d’apprentissage, recrutement, gestion des contrats d’apprentissage, coordination entre les différentes entreprises, accompagnement des personnes formées, mise à disposition de formats d’échange et organisation d’événements. - Services dédiés à la formation initiale stricto sensu
Pour l’essentiel, « formation à la pratique professionnelle » dans un centre de formation, parfois sous la forme de cours interentreprises ou (dans des cas exceptionnels) d’offres scolaires. Les modèles incluant un centre de formation permettent de mettre des infrastructures coûteuses en commun tout en garantissant un niveau de qualité standard et en réduisant les temps d’apprentissage au sein des entreprises. - Services complémentaires
Formations continues destinées aux professionnels, offres de formation transitoire ou coaching. Ces offres ont généralement pour but de mieux exploiter l’infrastructure et le personnel disponibles tout en simplifiant les transitions vers la vie active.
4 Les différents formats existant aujourd’hui
A) Réseaux d’entreprises formatrices avec centre de formation
Ce sont généralement des organismes autonomes (dépendant souvent du droit associatif) en partie portés par quelques grandes entreprises ou quelques secteurs. Ces organismes dispensent les compétences de base professionnelles de manière centralisée – ce qui peut durer jusqu’à deux ans selon le métier –, puis renvoient les personnes formées vers les réseaux d’entreprises formatrices. Il s’agit d’un modèle très courant dans les secteurs technico-industriels, pharmaceutiques et informatiques. Dans de nombreux cas, les réseaux sont financés par les cotisations des entreprises participantes. Les subventions publiques servent principalement à financer les cours interentreprises ou certains projets ciblés.
B) Réseaux d’entreprises formatrices sans centre de formation
Ces réseaux se concentrent sur les sujets liés à l’administration, à la coordination et à l’accompagnement, en particulier des petites et moyennes entreprises. Ils sont plus souvent (co)financés par des fonds publics, et ce afin, par exemple, de venir en aide aux jeunes défavorisés ou encore d’attirer des entreprises étrangères vers la formation. En l’absence de subventions, ces réseaux restent généralement modestes, avec peu de personnel. Leur croissance est compliquée dans la mesure où la propension à investir des entreprises est limitée.
C) Réseaux de petite taille pilotés pour l’essentiel par une entreprise
Bien que longtemps favorisé par le monde politique, ce modèle est aujourd’hui peu diffusé dans la pratique. Les secteurs qui se sont penchés dessus (l’industrie forestière, par exemple) ont généralement fini par y renoncer. Le modèle a été détrôné par les formations complémentaires, devenues une alternative pragmatique. Ces formations complémentaires sont dispensées mutuellement par des entreprises de formation similaires (par exemple des entreprises hôtelières ou agroalimentaires), ou bien par de grandes entreprises dans le but d’apporter un complément ponctuel aux structures plus modestes. Ces interventions ponctuelles durent généralement quelques jours à quelques semaines, s’effectuent souvent sans donner lieu à une rémunération formelle et reposent essentiellement sur la confiance.
D) Grandes entreprises et administrations publiques
Si les formations professionnelles qu’elles dispensent sont coordonnées de manière centralisée, les grandes entreprises sont elles aussi considérées comme des réseaux d’entreprises de formation.
Si les formations professionnelles qu’elles dispensent sont coordonnées de manière centralisée, les grandes entreprises sont elles aussi considérées comme des réseaux d’entreprises de formation. Ces entreprises choisissent généralement le modèle du réseau intercantonal pour éviter les autorisations multiples et pouvoir effectuer des rotations entre elles. Les administrations publiques organisent elles aussi parfois leurs formations professionnelles au sein de réseaux : c’est par exemple le cas des villes de Zurich et de Winterthour. Cette particularité est la principale raison pour laquelle quantité d’apprenants et d’apprenantes effectuant leur formation de base à l’intérieur d’un réseau obtiennent un CFC d’employé·e de commerce à l’issue de leur cursus.
E) L’enchaînement de contrats d’apprentissage
Fréquent dans le secteur agricole, notamment, ce modèle s’accompagne souvent d’étapes ultérieures clairement organisées ainsi que d’une cellule de coordination faisant office d’« organe de pilotage » factice. Dans certains cantons, on passe par un réseau ne disposant pas de centre d’apprentissage. Dans les deux cas, le système consiste quoi qu’il en soit à changer systématiquement de lieu de formation.
5 Système de rotation
Sauf contextes particuliers, l’idée sous-jacente principale de la rotation, qui consiste à passer régulièrement d’une entreprise spécialisée à une autre, ne s’est imposée que de manière limitée. Nombreuses sont les entreprises souhaitant maintenir les personnes en apprentissage plus longtemps, et ce parce que ces personnes ne peuvent contribuer au travail productif qu’une fois leur familiarisation avec l’entreprise et ses processus achevée. Pour cette raison, les rotations prennent souvent la forme suivante :
- format court (p. ex. brèves rotations de trois mois seulement) ;
- approche au cas par cas (et ce afin d’éviter les résiliations de contrats d’apprentissage) ;
- ou bien approche contextuelle (modèles subventionnés, monde agricole) – les formations générales ciblées passant plus souvent par des centres de formation (compétences de base) ou des formations complémentaires que par le système des rotations systématiques annuelles.
6 Conclusion
6.1 Pourquoi le modèle des réseaux n’est-il pas plus répandu ?
Deux perspectives se retrouvent ici imbriquées, à savoir :
- La situation économique des entreprises. La coopération entraîne des coûts supplémentaires liés à la coordination, au transfert des personnes formées, à leur apprentissage en interne et, dans certains cas, des coûts d’opportunité également. Les bénéfices pour l’entreprise (productivité des personnes en formation, accès à des profils adaptés, assurance qualité) se matérialisent différemment selon la taille de celle-ci, le métier concerné et l’organisation du travail. Pour beaucoup de petites et moyennes entreprises, les comptes n’y sont donc pas forcément, et cela est particulièrement vrai quand ces entreprises sont autorisées à dispenser des formations initiales hors réseaux également.
- La législation et les options disponibles. À l’heure actuelle, les entreprises hautement spécialisées peuvent elles aussi obtenir une demande d’autorisation de former des apprenti·es si elles remplissent les conditions minimales (par exemple en ce qui concerne la qualification du personnel de formation ou le ratio personnel professionnel/personnes apprenties). Les anciennes directives obligeant à passer par des partenaires pour couvrir certaines parties de la formation ont été assouplies, faisant de facto disparaître le caractère incitatif de l’ancienne réglementation, et par conséquent la motivation à rejoindre un réseau ou à organiser systématiquement des formations complémentaires. Conséquence de ce changement : les réseaux se retrouvent aujourd’hui mis en concurrence avec l’alternative « on s’occupe de la formation nous-mêmes », ne s’imposant plus que là où les prestations promises apportent une valeur ajoutée clairement démontrée.
6.2 Classification
Les réseaux d’entreprises formatrices ne créent pas automatiquement des places en apprentissage supplémentaires, ils prennent différentes formes et leur succès est principalement assuré là où ils proposent des prestations clairement définies dont l’intérêt concret est évident.
Les résultats obtenus confirment les observations internationales : les réseaux d’entreprises formatrices ne créent pas automatiquement des places en apprentissage supplémentaires, ils prennent différentes formes et leur succès est principalement assuré là où ils proposent des prestations clairement définies dont l’intérêt concret est évident. Les modèles avec centres de formation transmettant efficacement les compétences de base tout en assurant une qualité constante sont particulièrement viables. Quant aux réseaux ne disposant d’aucun centre, ils se maintiennent là où des objectifs publics sont poursuivis (ainsi l’égalité des chances, un certain taux de certification du degré secondaire II ou encore une stratégie d’internationalisation), ou bien là où certains secteurs veulent assurer la relève de leur personnel de façon ciblée.
6.3 Conclusions et recommandations
Considérer les réseaux d’entreprises formatrices comme des prestataires de services
Les réseaux d’entreprises formatrices doivent être essentiellement compris comme des fournisseurs de services spécifiques apportant une véritable plus-value économique et qualitative aux entreprises, en particulier dans les domaines du recrutement, des qualifications de base dispensées par les centres de formation, du coaching d’accompagnement ou encore de la répartition des personnes apprenties dans les entreprises convenant à leur profil.
Préciser quelles sont les exigences de qualité s’appliquant aux entreprises individuelles et les appliquer
Les entreprises hautement spécialisées doivent dispenser des formations initiales complètes soit en passant par des structures de réseaux, soit en recourant au système de formations complémentaires, ou alors elles doivent – dans la mesure du possible – satisfaire à des exigences formelles plus élevées. Cela permettrait d’augmenter l’attractivité des coopérations sans désavantager les entreprises formatrices classiques.
Orienter stratégiquement les subventions publiques
Les subventions sont utiles en premier lieu là où des objectifs sociaux sont poursuivis, ainsi l’aide apportée aux jeunes défavorisés, le développement des capacités de formation sectorielles ou encore la mise en place d’offres de formation régionales. Les subventions allouées doivent s’accompagner d’indicateurs de performance mesurables tels que le taux d’obtention de diplômes, la stabilité des apprentissages dispensés ou encore les transitions vers la vie active.
Renforcer le rôle joué par les organisations professionnelles
Les associations professionnelles peuvent aider les modèles de réseaux à s’implanter plus durablement en faisant converger la demande, en mettant en place des standards de qualité ainsi qu’en promouvant les pratiques axées sur l’innovation (par exemple l’utilisation de nouvelles technologies d’apprentissage ou encore le recrutement assisté par l’établissement préalable d’un diagnostic).
S’appuyer sur une approche différenciée des rotations
Les changements réguliers d’entreprise ne constituent en aucun cas un principe universel. Ils doivent être mis en place là où ils se révèlent être économiquement avantageux et où ils semblent systématiquement apporter un atout pour la formation (par exemple dans le secteur agricole ou dans le cas des modèles subventionnés). Dans les contextes différents, l’obtention d’une qualification plus générale peut être assurée en passant par les centres de formation ou par le modèle des formations complémentaires.
Le texte ici présent est une synthèse de l’ouvrage suivant (publié en allemand uniquement) : Maurer, M., Zanola, L. et Hauser, K. (2024). Ausbildungsverbünde: Zusammenarbeit im Kontext von Lehrstellen- und Fachkräftemangel. Berne : hep.
Literatur
- BMBF (2024). Berufsbildungsbericht 2024. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung.
- Bundesrat (2003). Ordonnance sur la formation professionnelle (Berufsbildungsverordnung, BBV) vom 19. November 2003 (Stand am 1. April 2022) (Vol. SR 412.101). Bern: Bundeskanzlei.
- Bundesversammlung (2002). Loi fédérale sur la formation professionnelle (Berufsbildungsgesetz, BBG) vom 13. Dezember 2002. Bern: Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
- Dornmayr, H. (2023). Lehrlingsausbildung im Überblick 2023: Strukturdaten, Trends und Perspektiven. Wien: ibw – Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft.
- Ebbinghaus, M., & Dionisius, R. (2020). Betriebliche Ausbildungskooperationen: Analysen zu Kooperationsbereichen und -mustern auf Grundlage des Referenz-Betriebs-Systems (RBS). Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis(4), 16–20.
- Gertsch, M. (1999). Der Lehrstellenbeschluss 1 – Evaluation: Ausbildungsverbünde. Bern: BBT / Koordinationsstelle für Weiterbildung der Universität Bern.
- Lachmayr, N. (2009). Chancen und Barrieren von Ausbildungsverbünden: Die Sicht österreichischer Unternehmen. BWP(3), 52–55.
- Leemann, R. J. (2019). Educational Governance von Ausbildungsverbünden in der Berufsbildung – die Macht der Konventionen. In Langer, R. / Brüsemeister, T. (Hrsg.), Handbuch Educational Governance Theorien (S. 265–287). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Maurer, M., Zanola, L., & Hauser, K. (2024). Ausbildungsverbünde: Zusammenarbeit im Kontext von Lehrstellen- und Fachkräftemangel. Bern: hep.
- CSRE (2023). Rapport sur l’éducation 2023. Aarau : Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation
Citation
Maurer, M. (2025). Les réseaux d’entreprises formatrices comme prestataires de services. Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique 10 (13).