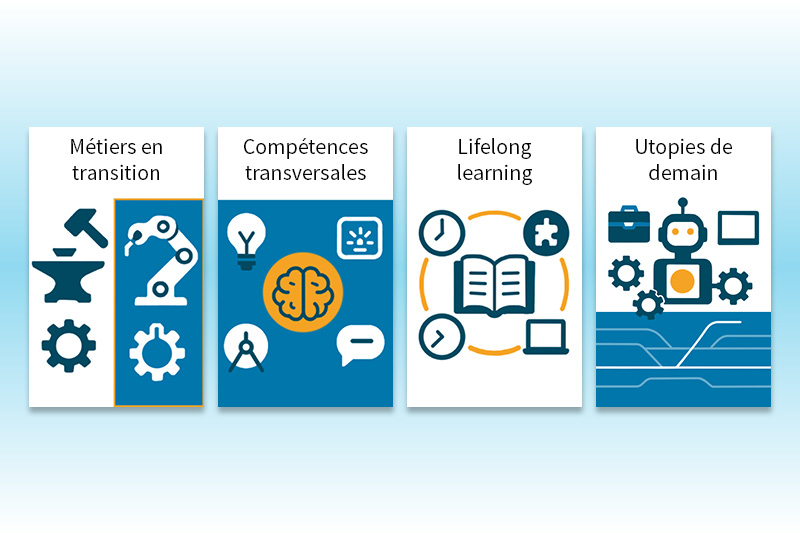« Formation professionnelle 2040 – perspectives et visions » : la formation professionnelle ne doit pas devenir un second choix !
Rester forts dans un monde en pleine transformation
La formation professionnelle devrait faire face plus activement à ses défis actuels. Ruptures d’apprentissage, problèmes d’image et surmenage des jeunes : voici trois problématiques qui réclament des réactions plus audacieuses. Entre autres, un meilleur comportement vis-à-vis des jeunes, l’intégration des langues étrangères dans toutes les formations professionnelles initiales, des environnements d’apprentissage plus innovants et des campagnes pour améliorer l’image de l’apprentissage. Mais pour cela, ce sont tous les partenaires de la formation professionnelle qui doivent s’activer.
Quand les photos devinrent numériques – souvenirs d’une transformation
La formation professionnelle s’est-elle trop longtemps reposée sur ses points forts et ses succès ?
J’ai effectué mon apprentissage au début des années 90, dans une entreprise de graphisme. La transformation numérique avait déjà commencé pour la production et la retouche de photos, et les premiers gros scanners à cylindre arrivaient sur le marché. Mon maître d’apprentissage était un expert en production analogique : un vrai artiste dans le maniement des bancs de reproduction, des pellicules et des révélateurs et fixateurs chimiques. C’était une « star » dans notre entreprise, parce qu’il était capable, en découpant et collant des éléments, de créer des photomontages qui n’avaient pas leur pareil à l’époque. Lorsque Crosfield Electronics commercialisa un ordinateur qui permettait la retouche numérique, j’ai vite compris que dans notre entreprise, nous n’aurions bientôt plus besoin de pellicule. Mon formateur n’était pas convaincu par cette nouvelle technologie, car la qualité des premiers scans était en effet encore défectueuse et insuffisante. Il essaya de prouver que l’on pouvait enrayer l’avancée de la production numérique en fournissant un travail analogique encore meilleur, et un degré de perfection élevé. Une tentative désespérée, comme nous le savons aujourd’hui. Il refusa d’apprendre à utiliser la technologie numérique. Et quelques années plus tard, il fut licencié car il n’avait plus aucune utilité dans la production.
Ce qui s’est ainsi déroulé dans mon environnement personnel, cela était déjà arrivé précédemment, à petite et grande échelle au fil des siècles. Les constructeurs de navires à voile avaient résisté à l’arrivée des navires à vapeur en montant des voiles supplémentaires, en vue d’atteindre une plus grande vitesse que leurs concurrents à vapeur. Ou un exemple de notre temps : le groupe finlandais Nokia, leader du marché à l’époque, a manqué le passage à la technologie des smartphones parce qu’il est resté trop longtemps convaincu de sa propre voie, et n’a pas cru à ce qui s’esquissait déjà des années avant la production du premier iPhone.
Aujourd’hui, c’est la formation professionnelle qui doit passer cette épreuve. Elle intègre des jeunes gens sur le marché du travail, elle ouvre des perspectives aux personnes migrantes et elle alimente l’économie : en Suisse, sa force est incontestée. Et pourtant, elle perd manifestement de son attrait : beaucoup mettent fin à leur apprentissage avant terme, environ 10’000 places d’apprentissage restent inoccupées en 2025, et les jeunes se plaignent de paroles trop rudes et de troubles psychiques. La formation professionnelle s’est-elle trop longtemps reposée sur ses points forts et ses succès ?
Les problématiques : de quoi souffre la formation professionnelle aujourd’hui
Image et attrait – surtout en ville et en Suisse romande
À l’échelle internationale, en beaucoup d’endroits, la formation professionnelle reste considérée comme un « second choix » (Cedefop 2024). En Suisse, on observe cette tendance dans les espaces urbains, mais aussi dans certaines zones de la Suisse romande. Dans le canton de Bâle-Ville, un nombre proportionnellement plus élevé de jeunes opte pour le gymnase ; tandis que dans les cantons ruraux, ils sont plus nombreux à choisir l’apprentissage. Cela nous montre qu’en ville, l’image attachée à l’apprentissage professionnel est plus mauvaise, puisque les cursus universitaires y sont préférés. C’est justement dans ces endroits qu’il s’agit alors de travailler son image de façon ciblée, afin que la voix duale y soit considérée avec la même valeur.
Les ruptures d’apprentissage : une sonnette d’alarme
La requête des huit semaines de vacances et le rejet, en réaction, de la part de l’Union des arts et métiers laissent pour le moins penser que deux visions adverses s’affrontent.
En Suisse, environ 24% des contrats d’apprentissage sont résiliés avant terme : en 2019, ce taux s’élevait à 24.3% (OFS 2023). Ce qui est particulièrement consternant, c’est que 62% de ces ruptures ont lieu au cours de la première année d’apprentissage. C’est le signe d’un système dont la structure est en danger : pour cause de mauvais choix de métier, d’une mauvaise culture d’entreprise, de manques d’accompagnement ou tout simplement de surmenage. Serait-ce possible que les entreprises se soient trop peu adaptées aux besoins des jeunes d’aujourd’hui ? La requête des huit semaines de vacances et le rejet, en réaction, de la part de l’Union des arts et métiers laissent pour le moins penser que deux visions adverses s’affrontent.
Surcharge psychosociale et manque de soutien
Surcharges psychiques et surmenage (souvent doublés de problèmes d’ordre privé) n’ont de cesse d’augmenter : tous ces troubles influent sur les ruptures d’apprentissage (HEFP 2022). À l’âge de 15 ou 16 ans, venus tout droit de cercles familiaux bien protégés, beaucoup de jeunes se trouvent tout simplement débordés par un monde du travail souvent rude. Et dans beaucoup d’entreprises, ils ne rencontrent pas de soutien systématique ; tandis qu’un tel soutien n’est pas toujours disponible à bas seuil au sein des écoles professionnelles. En demandons-nous trop à nos jeunes, ou est-ce la voie du gymnase qui est simplement plus confortable ?
Solutions possibles : comment la formation professionnelle peut rester forte
La culture d’entreprise est une clé
Dans les entreprises tout comme dans les écoles : là où la peur, la hiérarchie et la pression règnent, il n’y a pas de place pour la confiance ; ni d’ailleurs pour l’innovation. En plus d’instructions, les apprentis ont aussi besoin de possibilités de participation, de retours constructifs, de soutien et aussi d’un peu de liberté. Les entreprises et les branches qui rendent cela possible voient diminuer leur nombre de ruptures d’apprentissage et accroître leur attrait (HEFP 2022). Encore bien trop souvent, les apprentis sont utilisés comme de la main-d’œuvre bon marché, des agents d’entretien ou des sbires. Malheureusement, l’accent n’est alors pas mis sur l’aspect de formation, ni sur l’estime de leur travail. Mais à l’inverse, les entreprises formatrices sont en droit d’exiger une certaine performance, surtout si elles s’acquittent bien de leur mission première en tant que lieu de la formation pratique.
Offensive sur l’image de la formation professionnelle
En particulier dans les centres urbains, la formation professionnelle duale doit gagner en visibilité : il s’agit de mettre en avant tous ses attraits. Ceci peut avoir lieu, par exemple, sous forme de rencontres de réseautage, d’interventions de personnes servant de modèles, ou encore sous forme de collaboration avec les gymnases et les universités. Jusqu’ici, la potentialité d’aborder les parents n’a pas encore été beaucoup exploitée. En effet, lorsqu’on ne connaît pas un système, on adopte parfois une position critique à son égard. C’est pourquoi les campagnes devraient viser les jeunes et leurs parents dans les villes et les agglomérations, afin d’accroître la visibilité du système dual comme une voie de carrière et de pointer le doigt sur des options d’études alternatives dans la formation professionnelle supérieure et les hautes écoles spécialisées.
Les langues comme facteur d’attrait
Les entreprises devraient encourager les langues comme faisant partie intégrale de la formation, et considérer la langue comme une valeur ajoutée et une source d’innovation.
La Suisse est un pays multilingue avec quatre langues officielles et, de plus en plus souvent, l’anglais comme langue des affaires. Dans le monde du travail, les compétences linguistiques y sont décisives au quotidien. Des programmes tels qu’Erasmus+ ou Movetia permettent de réaliser un séjour à l’étranger et promeuvent les compétences linguistiques et interculturelles ; toutefois, ces programmes ne sont pas activement encouragés par la plupart des actrices et acteurs de la formation professionnelle. Dans la majorité des entreprises, on se concentre sur l’apprentissage par la pratique : les aspects éducatifs supplémentaires n’y trouvent alors pas leur place, que ce soit dans le domaine des langues, des compétences transversales ou d’autres facultés complémentaires. Les entreprises devraient encourager les langues comme faisant partie intégrale de la formation, et considérer la langue comme une valeur ajoutée et une source d’innovation. Bien entendu, il s’agit de charges supplémentaires. Mais sans cela, le manque de main-d’œuvre spécialisée continuera d’augmenter, avec des conséquences plus graves que la possibilité d’opter, de façon stratégique, pour un plus fort investissement dans la formation des jeunes.
Ouvrir les bras à l’innovation
Dans le secteur de la technologie, les cycles d’innovation sont rapides, si bien que de nombreux champs professionnels se transforment à une vitesse vertigineuse. Il faut y voir une opportunité, et intégrer ces innovations dans les contextes d’enseignement et d’apprentissage. Les écoles professionnelles, les cours interentreprises et les entreprises formatrices doivent employer les nouveaux outils de manière systématique, accepter les erreurs comme une opportunité d’apprentissage et impliquer les élèves dans l’innovation, afin d’accroître leur motivation et leur expérience pratique. Aux Pays-Bas par exemple, dans le Horti Garden Center de Westland, il existe une école professionnelle qui fait participer les élèves à ses travaux de recherche dans le domaine de l’agriculture durable en serre de haute technologie. Ils sont ainsi initiés à la recherche et au développement, dans la pratique ou dans leur formation professionnelle ; de plus, on les sollicite et les encourage en leur faisant mener leurs propres projets sophistiqués. Peut-être ne croyons-nous pas suffisamment en nos apprentis ?
Marges de liberté, confiance, intelligence collective
Un bon mode de gestion doit laisser de la place au dialogue, à l’expérimentation, à la réflexion et à l’apprentissage par les pairs. Les apprentis devraient très tôt être impliqués dans les procédures et débats comme des employés ou travailleurs à part entière, que ce soit en entreprise, dans les centres de cours interentreprises ou à l’école professionnelle. Car lorsqu’on est impliqué, on évolue plus vite. Autrement dit : les jeunes ont besoin qu’on leur confie des tâches qui leur permettent de se construire, ils ont besoin de modèles sur lesquels s’orienter, et ils ont besoin d’équipes dans lesquelles ils se sentent entre de bonnes mains.
Vision 2040 – la formation professionnelle comme moteur de l’innovation et de l’intégration
Les tendances que nous discernons déjà aujourd’hui vont se renforcer d’ici l’année 2040. Si nous ne parvenons pas à y faire face et à évoluer, la formation professionnelle va perdre du terrain.
Si elles y parviennent, les élèves ne verront pas la voie duale comme un second choix, mais se décideront consciemment pour cette dernière en raison des perspectives qu’elle offre sur le monde du travail, ainsi que de la reconnaissance et de la possibilité de formation continue.
Pour les entreprises et les associations de métiers, la priorité dans ce contexte est de s’adapter à ces tendances et évolutions. Si elles y parviennent, les élèves ne verront pas la voie duale comme un second choix, mais se décideront consciemment pour cette dernière en raison des perspectives qu’elle offre sur le monde du travail, ainsi que de la reconnaissance et de la possibilité de formation continue ; tout cela dans une atmosphère de travail respectueuse, axée sur la formation. Les entreprises formatrices, les cours interentreprises et les écoles professionnelles doivent collaborer, assurer ensemble une bonne culture d’apprentissage et encourager la diversité linguistique et professionnelle. Alors la formation professionnelle suisse restera le moteur central de l’intégration, de l’innovation et du progrès durable.
Bilan
L’apprentissage dual est l’une des plus grandes forces de la Suisse : il est innovant, inclusif et proche du marché du travail. Mais son image est en déclin, le nombre de ruptures d’apprentissage est élevé et surtout dans les villes, l’apprentissage dual est considéré comme peu attrayant ou il est vu comme un second choix. Une partie de solution repose dans l’évolution durable des structures, une autre partie majeure dans l’évolution de la culture de collaboration. Cela signifie l’installation de cultures d’apprentissage qui encouragent la confiance, renforcent la participation, considèrent la langue comme une ressource et impliquent plus activement les apprentis dans les zones d’expérimentation de l’entreprise. Avec de tels environnements pour apprendre, la formation professionnelle sera, à l’avenir aussi, une offre de premier choix. Si nous parvenons à incarner cette position, la Suisse restera en 2040 un modèle mondial pour la formation duale.
Sources
- OFS (2023): Résiliation du contrat d’apprentissage, réentrée, statut de certification.
- Cedefop (2024): Improving VET image and attractiveness. Link
- HEFP (2022): Décrochage en formation professionnelle duale.
- Movetia (2025): Stage en Suisse pour apprenti-e-s.
- HEFP (2024): Centre de compétences bili et langues (CBL).
Citation
Hüter, B. (2025). Rester forts dans un monde en pleine transformation. Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique 10 (11).