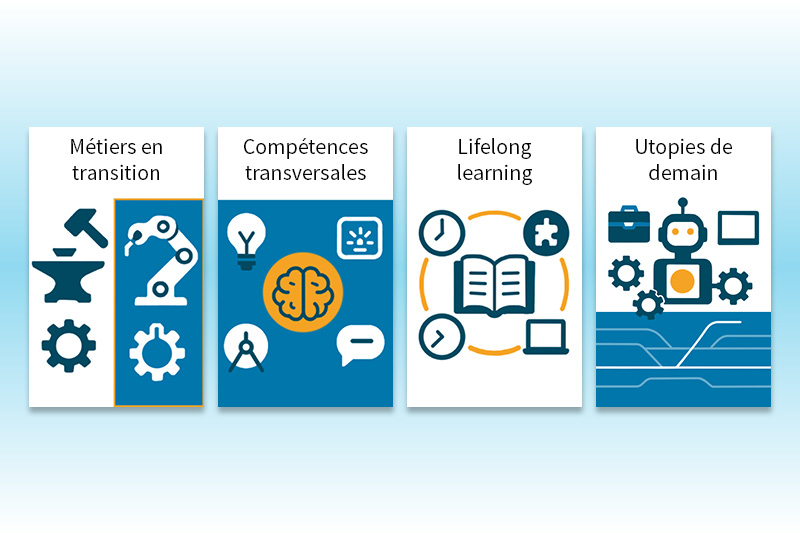« Formation professionnelle 2040 – perspectives et visions »: Le rôle des cantons
Comment les cantons peuvent rendre la formation professionnelle encore meilleure
Les cantons sont chargés de l’administration de la formation professionnelle et du maintien d’un haut niveau de qualité. Mais bien plus encore, ils contribuent aussi activement à sa conception : un rôle qu’il s’agirait d’endosser encore plus fortement qu’ils ne l’ont fait jusqu’ici. Pour y parvenir, il ne suffit pas de rédiger des documents stratégiques ambitieux, il faut également une mise en œuvre axée sur les résultats et une coopération pragmatique entre les cantons. Cela implique aussi l’évaluation systématique de toute innovation. Car on observe un désert empirique pour diverses thématiques éducatives majeures : par exemple, dernièrement, lors du projet « Culture générale 2030 ». Une approche prometteuse repose dans l’idée d’un système de suivi, auquel réfléchit actuellement la CSFP pour l’enseignement général.
Car leurs réformes n’atteignent pas de résultats grâce à des concepts empruntés à des précurseurs, contenant de grands mots qui sonnent bien et font le buzz ; mais grâce à une mise en œuvre durable suivant la roue de Deming : Plan – Do – Check – Act ; planifier, mettre en œuvre, contrôler et (ré)agir.
Les cantons sont chargés de l’administration de la formation professionnelle et du maintien d’un haut niveau de qualité qui enthousiasme les élèves. Mais bien plus encore, ils contribuent aussi activement à sa conception : un rôle qu’il s’agirait d’endosser encore plus fortement qu’ils ne l’ont fait jusqu’ici. Ce qui les aidera, ce ne sont pas tant des documents de stratégie ambitieux, mais plutôt une collaboration pragmatique entre les différents cantons. Cela implique aussi l’évaluation systématique de toute innovation. Car on observe un désert empirique pour diverses thématiques éducatives majeures : par exemple, dernièrement, lors du projet « Culture générale 2030 ». Une approche prometteuse repose dans l’idée d’un système de suivi, auquel réfléchit actuellement la CSFP.
La formation professionnelle constitue l’épine dorsale de l’économie et de la société. La mission du service de la formation professionnelle et continue du canton de Lucerne consiste à poursuivre continuellement, et de manière stratégique, le développement de la formation professionnelle. Les défis que nous rencontrons actuellement se reflètent dans les champs d’action du nouveau projet prioritaire du SEFRI, l’« Attrait de la formation professionnelle ». Parmi eux, on compte en particulier :
- susciter la disposition des entreprises à former des apprentis
- contrer la tendance à la formation générale
- rendre la formation accessible pour tous
- améliorer la qualité de la formation professionnelle
- faire de « l’orientation sur les résultats » un principe de base lors de la gouvernance
À Lucerne, nous sommes d’avis que les cantons, en tant que l’un des trois partenaires de la formation professionnelle, ne sont pas seulement administrateurs de cette dernière, mais doivent aussi participer activement à sa conception. Outre leur rôle légal qui concerne l’exécution et la surveillance, ainsi que celui du service public et du financement, les cantons possèdent un énorme potentiel à endosser, à l’échelle locale et régionale, une fonction centrale de moteurs de l’innovation et de l’efficacité. Pourquoi ? Parce que les cantons peuvent faire office de laboratoires pour toutes les idées de nouvelles mises en œuvre innovantes, servir de facilitateurs, créer un écosystème pour la conception de solutions locales et, grâce à l’implication des actrices et acteurs locaux, permettre un haut degré d’acceptation et un résultat durable. De plus, ils viennent compléter le partenariat de la formation professionnelle en portant un regard pragmatique sur l’aspect de la faisabilité : non pas comme empêcheurs d’innovation, comme on le leur reproche parfois ; mais plutôt dans le rôle d’un « ami critique » qui garde un œil sur l’application des ordonnances. Les cantons sont d’excellents connaisseurs des efforts propres à la poursuite sur le long terme. Car leurs réformes n’atteignent pas de résultats grâce à des concepts empruntés à des précurseurs, contenant de grands mots qui sonnent bien et font le buzz ; mais grâce à une mise en œuvre durable suivant la roue de Deming : Plan – Do – Check – Act ; planifier, mettre en œuvre, contrôler et (ré)agir.
Le potentiel présenté par les cantons peut être bien explicité en suivant les cinq défis susmentionnés.
1. Disposition des entreprises à former des apprentis
Les entreprises formatrices constituent le fondement de la formation professionnelle ; et les formatrices et formateurs en sont les acteurs centraux. Pour maintenir l’attrait de la formation professionnelle, il faut des formateurs et formatrices qualifiés, motivés et engagés. Un apprenti du canton de Lucerne déclare à ce propos :
« Ce que je préfère dans mon apprentissage ? C’est que j’ai rencontré des personnes extrêmement intéressantes qui marqueront ma vie. »
Nos derniers sondages ont indiqué que la satisfaction des formatrices et formateurs est en baisse ; et c’est en grande partie la sensation d’une lourde charge administrative qui est en cause. On y évoque aussi l’augmentation du temps à investir pour l’encadrement des apprentis. De plus, des ordonnances de formation de plus en plus complexes et des plateformes d’apprentissage également compliquées – pourtant conçues comme une ressource dans la meilleure des intentions – sont perçues par les utilisatrices et utilisateurs, dans la pratique, plutôt comme un obstacle et une tendance à tout « scolariser ». Les retours exprimés par les entreprises formatrices doivent être pris plus au sérieux dans le cadre du développement des professions, au sens du « Check and Act » de la roue de Deming.
Les cantons aussi exercent une influence sur la disposition des entreprises à former des apprentis. Dans le canton de Lucerne, nous nous efforçons d’encourager cette disposition, entre autres par les moyens suivants :
De plus, nous nous engageons à alléger autant que possible la charge administrative des entreprises formatrices. Grâce à des sondages réguliers, nous connaissons plutôt bien les problématiques des entreprises et nous savons comment leur venir en aide.
Soutien aux formatrices et formateurs en entreprise. Les travaux de recherche très réputés de la HEFP (Wenger & Lamamra, 2024) ainsi que le projet « Formation professionnelle 2030 – renforcement des compétences de formation au sein des entreprises » ont fourni des pistes importantes pour le soutien des formatrices et formateurs en entreprise, notamment par le biais d’offres de formation continue et de consultation. En complément des offres spécifiques aux secteurs, nous développons de nouveaux services d’assistance et de formation continue, flexibles et bon marché, au centre cantonal de formation continue WBZ. Nous y montrons aux formatrices et formateurs, entre autres, comment apporter leur soutien aux apprentis dans des situations difficiles, comment améliorer leur résilience et appliquer des techniques de formation appropriées.
De plus, nous nous engageons à alléger autant que possible la charge administrative des entreprises formatrices. Grâce à des sondages réguliers, nous connaissons plutôt bien les problématiques des entreprises et nous savons comment leur venir en aide
Estime envers les formateurs et formatrices en entreprise. Nous renforçons la reconnaissance sociale et politique des formatrices et formateurs : entre autres grâce à des formats tels que les « apéros de l’estime » ou les « entretiens lucernois sur la formation professionnelle ». Notre objectif : rendre plus visible la contribution de milliers de formatrices et formateurs engagés qui fournissent un service énorme à la société.
Introduction d’un fonds en faveur de la formation professionnelle dans le canton de Lucerne. Lucerne est le neuvième canton de Suisse à prévoir l’introduction d’un fonds en faveur de la formation professionnelle. Tous les employeurs et employeuses y contribuent ; et une partie des fonds récupérés revient aux entreprises avec un nombre d’apprentis approprié. Chaque année, ce sont environ 7.5 millions de CHF qui seront redistribués ; dont 15% qui sont affectés à des projets et innovations pour la consolidation de la formation professionnelle initiale, tandis que le reste revient aux entreprises formatrices. Cet instrument permet de soulager directement ces dernières, tout en promouvant les initiatives entrepreneuriales au bénéfice de la formation professionnelle.
2. Tendance à la formation générale
Dans des cantons comme Lucerne, où un grand nombre de chefs d’entreprise ont, de leur temps, suivi une formation duale, un gros avantage du système subsiste pour le moment encore : ici, la formation professionnelle bénéficie d’une très bonne renommée. Le taux de fréquentation des gymnases s’élève à environ 20% et reste stable : il s’agit du taux voulu par les politiques. On observe toutefois des divergences entre les régions urbaines et rurales. Chez les populations urbaines, l’apprentissage classique perd de son attrait.
Pour contrer à cette évolution, la formation professionnelle a besoin de plus d’assurance et de visibilité : dans les écoles, la politique, l’économie et la société. Pour cela, le processus du choix de métier joue un rôle central. Il doit commencer tôt, sera maintenant transmis sous forme de modules et implique activement parents, personnel enseignant et entreprises. L’objectif : une décision bien fondée quant au choix de profession ou de formation. À Lucerne, ce processus fonctionne sans accroc, grâce à une bonne collaboration entre les conseillères et conseillers d’orientation professionnelle, les écoles et les entreprises. Stages, consultations individuelles, découverte précoce de champs professionnels et stages d’orientation permettent d’améliorer la qualité de cette décision, ainsi que l’ajustement du choix de métier aux aptitudes et intérêts de l’élève.
Avec un taux d’enseignement bilingue de 18%, Lucerne se situe aujourd’hui en tête de tous les cantons de Suisse ; entre autres grâce à l’application systématique d’une méthode de « Check and Act » en collaboration avec d’autres cantons.
Ce qui est important aussi, c’est l’existence de perspectives attrayantes pour les élèves performants. Lucerne est le premier canton à avoir introduit le modèle BM SEK+ (« maturité professionnelle secondaire + ») comme option alternative au gymnase de courte durée. Ce modèle permet aux élèves de commencer à suivre des cours pour la maturité professionnelle dès le degré secondaire I, et ainsi d’achever cette dernière avant la fin de l’apprentissage ordinaire. D’autres cantons se penchent actuellement sur la possibilité d’introduire ce même modèle. Il y a huit à douze ans déjà, des programmes d’encouragement des jeunes talents ont été lancés à Lucerne, ainsi que des projets de mobilité et un système d’enseignement bilingue (bili, en anglais). Leur mise en œuvre fut de longue haleine, mais durable : avec un taux d’enseignement bilingue de 18%, Lucerne se situe aujourd’hui en tête de tous les cantons de Suisse ; entre autres grâce à l’application systématique d’une méthode de « Check and Act » en collaboration avec d’autres cantons. Ces mesures suffiront-elles à un bon positionnement de l’apprentissage professionnel, ou d’autres interventions seront-elles nécessaires ? Les prochaines années nous le diront.
3. Rendre accessible la formation
Le « miracle de la formation professionnelle » (ainsi qualifiait Stefan C. Wolter la capacité de la formation professionnelle à promouvoir l’intégration, lors de la conférence d’automne à Saint-Maurice dans le canton de Vaud le 2 novembre 2023) parvient à atteindre des élèves doués intellectuellement ou en pratique, et intègre également les jeunes issus de la migration. En ce qui concerne la langue comme base de l’apprentissage, nous suivons à Lucerne une nouvelle approche stratégique qui consiste à promouvoir l’acquisition de l’allemand comme seconde langue (DaZ) selon une méthode qui rassemble tous les niveaux de l’éducation. De la stimulation linguistique précoce jusqu’à la formation professionnelle, en passant par l’école, l’objectif consiste à transmettre les compétences linguistiques (jusqu’au niveau B2) dont les élèves ont besoin pour leur réussite scolaire et professionnelle. Car la langue est la clé de l’intégration. Le soutien linguistique commence déjà avant l’école primaire, se poursuit sans interruption pendant tout le primaire et le degré secondaire I puis dans les écoles professionnelles ou au secondaire II et enfin dans la pratique professionnelle. Cette continuité est primordiale : en effet, les transitions entre les différents degrés éducatifs sont considérées comme des phases critiques, lors desquelles les besoins spécifiques passent souvent inaperçus et les mesures de soutien ne sont pas poursuivies sans interruption. Le modèle lucernois implique des contrôles systématiques du niveau linguistique, ainsi qu’un concept cadre commun qui permet de garantir la qualité et la cohérence des services proposés ; et une multitude d’offres disponibles. Ces dernières vont des cours intensifs jusqu’aux mesures de promotion de l’apprentissage linguistique en entreprise (par le biais, par exemple, d’un accompagnement à l’apprentissage ou de systèmes de mentorat), en passant par l’enseignement de l’allemand comme seconde langue dans les écoles professionnelles et au degré secondaire II. Ici aussi, il ne faut pas oublier que pour une mesure durable, il faut du temps : si bien que la mise en œuvre du projet est prévue sur une durée de trois ans.
4. Garantir et mesurer la qualité
La qualité a longtemps gardé l’image d’une « thématique démodée des années 90 ». Et pourtant, aujourd’hui, elle est plus importante que jamais ; surtout dans l’optique d’une formation qui se déroule à trois endroits différents : dans l’entreprise formatrice, dans les cours interentreprises (CIE) et à l’école professionnelle. En vertu de l’art. 24 de la LFPr, le contrôle de la qualité revient aux cantons : ils sont donc gestionnaires de la qualité au nom de la loi. Malheureusement, bien souvent, la qualité n’est thématisée qu’une fois que des problèmes surviennent, qu’il s’agisse de dissolutions de contrat ou de ruptures d’apprentissage.
C’est pourquoi le canton de Lucerne pose une priorité stratégique sur la qualité de l’enseignement, actuellement surtout au sein des écoles professionnelles. Celles-ci sont en train de revoir leur concept de qualité ainsi que leurs instruments employés à cet effet. Toutefois, la qualité n’est pas seulement une question d’instruments, mais surtout d’attitude ainsi que de concentration sur le processus d’apprentissage en soi. À ce sujet, voici une citation de Carl Bossard, recteur et fondateur de la PH Zug (Haute école pédagogique de Zoug) :
« Tout ce que l’école a à fournir doit passer à travers le goulet d’étranglement d’un cours de bonne qualité et bien concentré : celui de l’interaction entre un personnel enseignant et une classe. »
Au lieu de débattre de caractéristiques superficielles telles que les programmes ou les plateformes d’apprentissage, il s’agit de ne pas perdre de vue le processus d’apprentissage en lui-même : comprendre, exercer, appliquer.
Au lieu de débattre de caractéristiques superficielles telles que les programmes ou les plateformes d’apprentissage, il s’agit de ne pas perdre de vue le processus d’apprentissage en lui-même : comprendre, exercer, appliquer. Le cours d’un bon professeur doit être marquant et l’apprentissage doit y être efficace. Le personnel enseignant est formé à cela, et c’est ainsi qu’il produit un résultat. Nous sommes d’avis que le corps enseignant doit être pris au sérieux et conforté dans sa compétence pédagogique. Dans ce contexte, nos priorités sont de mettre en place des conditions d’emploi attrayantes et une bonne communauté au sein de l’école, gérer efficacement le personnel, orienter et façonner l’évolution de l’école et des cours et faire évoluer les enseignements.
Si les cantons jouent bien leur rôle de gestionnaires de la qualité, cela n’a pas l’air très spectaculaire. Mais tout cela présente un potentiel énorme pour l’attrait de la formation professionnelle. Car finalement, les personnes apprenantes sont les ambassadrices de la formation professionnelle : si elles gardent un souvenir positif de cette dernière et des personnes qui les ont marquées, c’est la meilleure des publicités pour ce type de formation. Elles se souviendront de leurs enseignantes et enseignants et de leurs formateurs et formatrices en entreprises, et non pas des concepts appliqués ni des outils d’apprentissage numériques employés.
5. Collaboration et orientation sur les résultats comme principes de base pour la gouvernance
Dans le canton de Lucerne, un grand nombre d’innovations ont vu le jour grâce à des initiatives individuelles, mais aussi, toujours, grâce aux expériences d’autres cantons. Sans l’expérience du canton de Zurich en matière d’enseignement bilingue, sans celle du canton du Valais pour les fonds en faveur de la formation professionnelle, du canton d’Obwald pour l’encouragement des jeunes talents et du canton de Saint-Gall pour les parcours d’apprentissage Moodle, nous n’aurions pas pu avancer. Alors même que, c’est bien connu, la coordination ou même la simple harmonisation des standards nationaux est fastidieuse ; en revanche, la collaboration entre cantons pionniers se révèle souvent très simple et efficace. Nous devrions donc nous appuyer dessus et en faire usage, d’autant plus que la culture de la collaboration est très constructive au sein du secteur de la formation professionnelle. C’est aussi pour cela que dans le canton de Lucerne, nous misons souvent sur des collaborations bilatérales.
La formation professionnelle a toujours été dynamique. Toutefois, certains de ses acteurs et actrices réclament une accélération et des solutions plus rapides. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne approche. Pourquoi ? Parce que « culture eats strategy for breakfast », comme le déclare Peter Drucker. On ne peut pas accélérer le système fédéral en prônant de simples recettes « one size fits all ». Au lieu de ne miser que sur une accélération des réformes et sur des documents de stratégie, nous devrions aussi réfléchir aux aspects de la mise en œuvre et du résultat. Au sens de la roue de Deming : ne pas se consacrer uniquement au « Plan » (des documents de stratégie sont vite rédigés et leurs belles paroles sont souvent séduisantes) mais prendre aussi en considération les étapes « Check » et « Act ».
Car dans diverses thématiques éducatives majeures (par exemple, dernièrement, dans le projet « Culture générale 2030 »), c’est un désert empirique qui apparaît.
C’est là justement que les cantons pourraient s’impliquer de manière plus forte et systématique : car dans diverses thématiques éducatives majeures (par exemple, dernièrement, dans le projet « Culture générale 2030 »), c’est un désert empirique qui apparaît. Il serait possible de le combler grâce à des expériences cumulées de manière systématique, et grâce à des connaissances bien fondées et des faits scientifiques. Une approche prometteuse réside dans l’idée d’un système de suivi, auquel réfléchit actuellement la CSFP (ou sa sous-commission Culture générale) en lien avec la nouvelle ordonnance sur la culture générale. Ce qui est important dans ce contexte : ce système de suivi basé sur des faits scientifiquement prouvés doit être structuré pour le partenariat de la formation professionnelle. Les expériences issues de la mise en œuvre (y compris celles des écoles professionnelles) doivent être répertoriées de façon élargie et être exploitées par des expertes et experts scientifiques indépendants.
Et une chose encore : il ne faut pas seulement donner plus de poids aux aspects « Check » et « Act », mais aussi moins à celui de « Doing ». On vise ici une réduction ciblée du nombre de projets, et un ralentissement focalisé et bien raisonné des innovations : moins de grands mots, plus de pilotage durable et axé sur les résultats. Et pour cette raison, les cantons ont bien le droit d’activer parfois le frein.
Bilan : que peuvent faire les cantons pour consolider la formation professionnelle ?
On prétend parfois que les cantons sont lents ou qu’ils sont hostiles aux innovations. Je vois cela différemment : si l’on considère le fameux « esprit de clocher » des cantons comme une attitude terre à terre et axée sur la réalité, alors ce même esprit peut apporter une contribution constructive au développement futur de la formation professionnelle. Tout ce qui a l’air moderne n’est pas forcément efficace. Parfois, c’est juste « cringe », pour utiliser une expression qui fait jeune. Pour résumer, les cantons peuvent :
- faire effet de laboratoires pour le développement de solutions proches de la pratique ;
- activer des acteurs, pionnières et précurseurs locaux, et engager ainsi un effet de motivation ;
- endosser la responsabilité de la mise en œuvre, de la mesure de l’efficacité et du suivi ;
- se mettre en réseau, partager leurs expériences, donner vie aux stratégies ;
- et parfois aussi lever le pied consciemment, dans leur rôle d’« ami critique ».
Si les cantons se considèrent comme un élément actif du partenariat de la formation professionnelle, comme un élément qui rend ce partenariat possible, ils apporteront alors une contribution fondamentale à la consolidation de la formation professionnelle. Le canton de Lucerne montre l’exemple.
Bibliographie
- Wenger, M., & Lamamra, N. (2023). Les besoins et préférences en matière de formation continue des personnes formatrices d’apprenti-e-s. Analyses de l’enquête en ligne – Rapport final. Renens: Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP
- Bossart, C. (2025). Bildung im Blindflug? Online Bildung im Blindflug? | Journal21
Citation
Preckel, D. (2025). Comment les cantons peuvent rendre la formation professionnelle encore meilleure. Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique 10 (10).