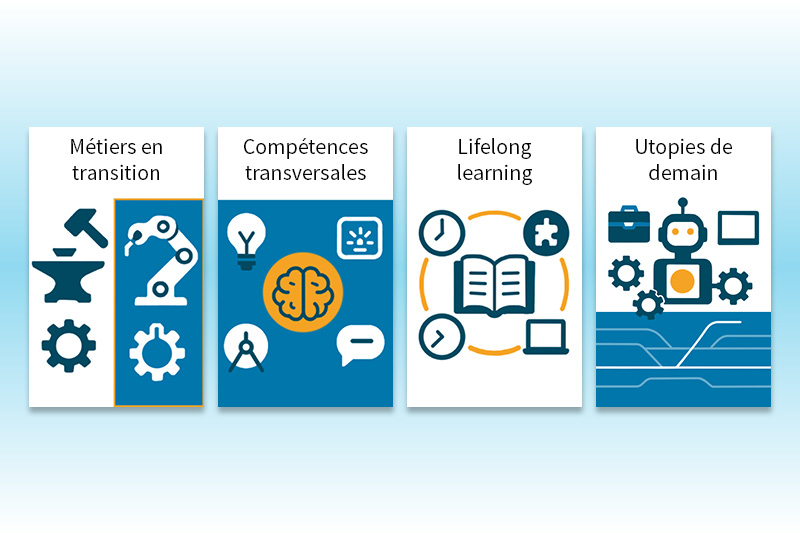Workshop de la HEFP sur les défis de la formation professionnelle
La qualité ! Objectif ou slogan pour la formation professionnelle ?
Le Winter Workshop de la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP) réunit chaque année des expert-e-s, des chercheur-euse-s et des praticien-ne-s du domaine de la formation professionnelle pour discuter des défis et des questions actuels. L’édition 2025 était consacrée à une question particulièrement brûlante : la qualité dans la formation professionnelle est-elle un objectif tangible ou un simple slogan ? L’une des conclusions : La qualité ne devrait pas être conçue comme un cadre figé, mais comme un processus de négociation et une réflexion continue sur les objectifs de formation et les rôles des différent-e-s acteur-rice-s.
Un terme aux multiples facettes
Car la qualité dépend toujours du contexte, des objectifs et des besoins des acteurs impliqués.
La qualité est une notion extrêmement complexe : ambiguë, abstraite, difficile à conceptualiser – et pourtant une référence centrale dans l’économie, l’administration, la science ou l’éducation. Selon la perspective, la qualité peut être appréhendée
- comme un idéal auquel on aspire, mais qui ne peut jamais être complètement atteint, ou
- en tant que résultat mesurable, qui reflète l’adéquation entre les objectifs fixés et les résultats effectifs
En raison de cette complexité, une définition uniforme de la qualité semble difficilement réalisable. Il est donc d’autant plus important de mettre en évidence les différentes compréhensions de la qualité, d’analyser leurs contextes et – lorsque cela est possible – d’identifier des dénominateurs communs. Car la qualité dépend toujours du contexte, des objectifs et des besoins des acteurs impliqués.
Dans le domaine de l’éducation – qu’il s’agisse de la formation scolaire, universitaire ou professionnelle – la question de la qualité se pose également de multiples façons. Depuis plus de deux décennies, la promesse de qualité est présente dans l’éducation, souvent associée à l’exigence de pilotage, d’évaluation et d’amélioration. Dans ce contexte, la qualité n’est pas seulement associée à l’excellence ou à l’innovation, mais aussi à la transparence, à la comparabilité et à l’obligation de rendre des comptes. La notion de qualité occupe une place centrale dans les textes de loi, les stratégies et les instruments d’évaluation, sans pour autant être définitivement clarifiée. Le défi consiste à concilier les différentes exigences de qualité entre les pratiques pédagogiques et les objectifs de la politique éducative.
La qualité est un thème central, notamment dans la formation professionnelle – et en même temps un domaine très disputé. La loi sur la formation professionnelle consacre un paragraphe spécifique au développement de la qualité et à la garantie des normes de qualité. Différent-e-s acteur-rice-s – de la Confédération et des cantons aux entreprises formatrices et aux institutions de formation, en passant par les associations professionnelles – sont subsidiairement responsables de la qualité dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure, la formation continue et la recherche en formation professionnelle. Dans ce contexte, des compréhensions et des intérêts différents s’affrontent : pour la politique et l’administration, les critères mesurables et comparables tels que les taux de réussite aux procédures de qualification ou le niveau de chômage des jeunes sont intéressants. Pour les entreprises formatrices, la qualité de la formation professionnelle réside parfois dans la capacité des apprenti-e-s à répondre aux exigences productives de l’entreprise. Du point de vue des apprenti-e-s, la qualité signifie entre autres accompagnement, reconnaissance et perspectives de développement. Cela soulève des questions centrales : Ces points de vue peuvent-ils être réunis dans un cadre commun ? Et quelle conception de la qualité devrait prévaloir ?
La qualité comme processus de négociation
Les discussions menées lors du Winter Workshop ont montré les nombreuses facettes de la notion de qualité et ont permis d’envisager différentes approches.
Il en résulte toutefois une tension entre les objectifs économiques (main-d’œuvre qualifiée et productive) et les objectifs sociaux (inclusion la plus large possible) de la formation professionnelle.
Giuliano Bonoli (Université de Lausanne) a souligné que la formation professionnelle est un élément central de la politique sociale, qui varie d’un pays à l’autre. Il en résulte toutefois une tension entre les objectifs économiques (main-d’œuvre qualifiée et productive) et les objectifs sociaux (inclusion la plus large possible) de la formation professionnelle. Il propose de mesurer la qualité d’un système de formation professionnelle à sa capacité à équilibrer ces deux objectifs. Afin de combiner l’attractivité et la capacité d’inclusion de la formation professionnelle, des mesures qui soit n’affectent pas directement les entreprises (p. ex. une 10e année scolaire), soit répondent à des besoins immédiats des entreprises (p. ex. des mesures d’intégration dans des professions souffrant d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée) sont prometteuses dans les systèmes de formation professionnelle collectifs.
Sandra Hupka-Brunner (Université de Berne) a abordé le sujet sous l’angle de la sociologie de l’éducation et s’est interrogé sur les indicateurs permettant d’analyser dans quelle mesure les objectifs politiques en matière de formation sont atteints, afin de juger de la qualité de la formation professionnelle en Suisse. Elle a expliqué que nous disposions déjà d’une vaste base de données, mais que le choix des critères de qualité était loin d’être trivial : considérons-nous la qualité en termes de perméabilité du système de formation, du retour sur investissement dans les filières de formation, du développement des compétences ou de l’activité de formation continue et de carrière ? En se basant sur les données de l’étude suisse longitudinale TREE (Transitions de l’éducation à l’emploi), Hupka-Brunner a argumenté que pour évaluer la qualité, il ne fallait pas seulement prendre en compte les voies théoriquement possibles au sein d’un système de formation, mais aussi les carrières effectivement suivies (ou non).
En jetant un regard critique sur les bases théoriques scientifiques de notre compréhension de la qualité, Jürg Schweri (HEFP) a attiré l’attention des personnes présentes sur les contradictions possibles dans nos conceptions de la qualité dans la formation professionnelle. Alors que certains aspects de la qualité peuvent être relevés avec une rigueur scientifique, leur interprétation (politique) n’est jamais exempte de présupposés normatifs. Dans le sens d’une compréhension commune de la qualité, nous pouvons certes décrire l’input, le processus et l’output sur la base de faits. En revanche, définir les objectifs à atteindre – et c’est là que réside l’essence même de la définition de la qualité – reste une tâche normative. Pour la recherche et les attentes éventuelles de la politique vis-à-vis des résultats de la recherche, on peut en conclure que la qualité de la recherche elle-même ne peut être garantie que si elle connaît les limites de ses propres capacités et si elle communique (ou défend) avec une certaine modestie les mesures possibles pour le développement de la (future) qualité de son objet – ici la formation professionnelle.
Kerstin Duemmler (HEFP) a considéré la qualité de la formation professionnelle sous l’angle de la durabilité – et vice versa la qualité de la durabilité. Tout comme la qualité, la durabilité dans la formation professionnelle est un objectif ancré dans la loi depuis plus de 20 ans. Mais tous deux reposaient sur des concepts insaisissables, chatoyants et pourtant omniprésents. Toutefois, la durabilité n’est pas (encore) considérée comme un élément central de notre conception de la qualité dans la formation professionnelle. Cela peut être lié à la qualité de notre compréhension de la durabilité dans la formation professionnelle : en Suisse, nous n’en sommes qu’au début d’une discussion différenciée sur ce que la durabilité pourrait signifier pour la formation professionnelle.
Une conception très étroite de la qualité, basée sur des indicateurs standardisés et liés à l’output, n’est pas appropriée dans le cadre d’une compréhension de la qualité sans cesse renégociée de manière discursive et parfois contradictoire.
Dans sa conclusion de la journée, Jakob Kost (PHBern) a souligné que la qualité doit rester un concept permettant d’encadrer les discussions entre différents acteurs à différents niveaux du système éducatif – et donc entre la recherche et la politique. Selon lui, le souhait d’une définition uniforme et définitive de la qualité est une perte de temps si nous ne considérons pas le processus de négociation lui-même comme un objectif. Dans ce sens, la formation professionnelle en Suisse ne doit pas non plus craindre un « tribunal de la qualité ». Une conception très étroite de la qualité, basée sur des indicateurs standardisés et liés à l’output, n’est pas appropriée dans le cadre d’une compréhension de la qualité sans cesse renégociée de manière discursive et parfois contradictoire. C’est ce qui ressort de toutes les contributions au Winter Workshop : la formation professionnelle et sa qualité vont bien au-delà de la transmission de qualifications et de l’aptitude au marché du travail. Elle remplit une fonction sociale, agit comme un espace de vie, donne des impulsions aux innovations sociales, politiques et économiques et joue un rôle central dans la société civile. Ces objectifs pluriels de la formation professionnelle doivent être compatibles avec notre conception de la qualité. La qualité ne doit pas être conçue comme une grille rigide, mais comme un processus de négociation et une réflexion continue sur les objectifs de formation et les rôles des différents acteurs. Les contributions et les discussions du workshop ont élargi le discours sur la qualité – et ont précisément mis en évidence cette complexité.
Conclusion : la qualité comme projet collectif
La qualité dans la formation professionnelle ne doit pas être réduite à un simple slogan. Elle est en effet plus un objectif qu’un slogan. La définition de la qualité et la mise en œuvre de mesures visant à la renforcer restent toutefois une tâche perpétuelle. La diversité des points de vue et des besoins exige une approche capable d’intégrer les perspectives interdisciplinaires de la recherche, les exigences normatives de la politique et les besoins pratiques orientés vers l’application. La qualité n’est pas un concept statique, mais doit être constamment remise en question et (re)développée en commun.
Le Winter Workshop a entamé ce dialogue. Les discussions ont principalement porté sur la capacité de la recherche en formation professionnelle à développer un récit commun sur la qualité ou, du moins, à établir un lien cohérent entre les différents points de vue disciplinaires. Il s’agit à bien des égards d’une condition nécessaire pour initier des démarches concrètes d’amélioration de la qualité dans la formation professionnelle. Il est prévisible que certaines questions restent ouvertes dans le cadre d’un échange interdisciplinaire. En revanche, il est devenu tout aussi clair que la recherche et la science doivent évaluer avec réserve les mesures visant à améliorer la qualité. Ceci pour des raisons épistémologiques, mais aussi parce que nos représentations de la qualité sont étroitement liées à des objectifs normatifs. Dans ce sens, le Winter Workshop a témoigné d’une grande qualité du discours sur les possibilités et les limites de notre compréhension de la « qualité » dans la formation professionnelle.
Lors du prochain Winter Workshop, début 2026, nous discuterons de justice et d’injustice dans la formation professionnelle. L’invitation sera publiée en automne. Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées à y participer.
Citation
Wenger, M., Ruoss, T., & Bonoli, L. (2025). La qualité ! Objectif ou slogan pour la formation professionnelle ?. Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique 10 (7).