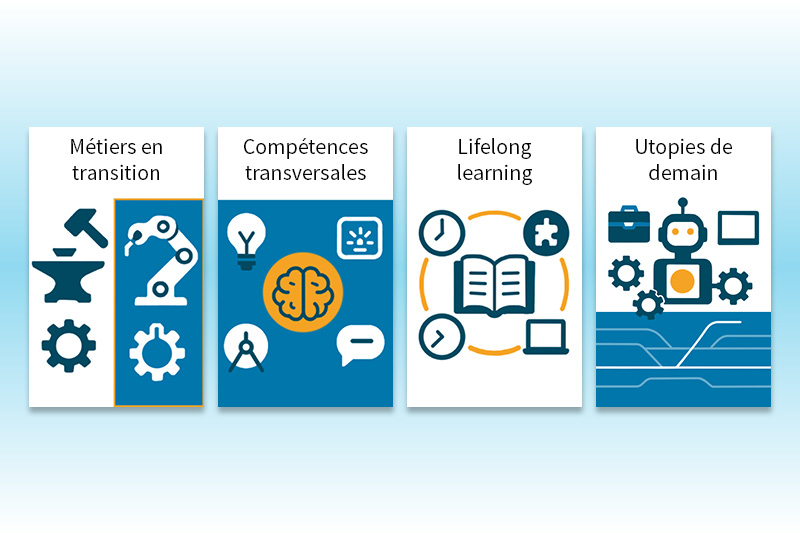De nombreux pays à travers le monde possèdent un système bien structuré de la formation professionnelle – même si les compétences sont principalement enseignées à l’école et durant des stages. L’Australie en est un exemple. Dans le cadre d’un séjour de formation continue, deux responsables de filières d’études de la Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP ont bénéficié d’un aperçu approfondi de la formation des enseignantes et enseignants de la formation professionnelle au Royal Melbourne Institute of Technology RMIT ainsi que du système australien de la formation professionnelle dans son ensemble. L’échange professionnel sur place à Melbourne a permis d’avoir des perspectives différenciées et des discussions enrichissantes. Indépendamment de ce séjour, un projet a été réalisé pour comparer la formation du corps enseignant des écoles professionnelles en Suisse et en Australie. Il offre des impulsions précieuses pour le développement continu des filières de formation suisses – y compris l’idée de mettre davantage l’accent sur la capacité à organiser des examens de qualité. Le projet a été soutenu par Movetia.